Fétis 1856 : "Stradivarius"
ANTOINE STRADIVARI
LUTHIER CÉLÈBRE
CONNUT SOUS LE NOM DE
STRADIVARIUS
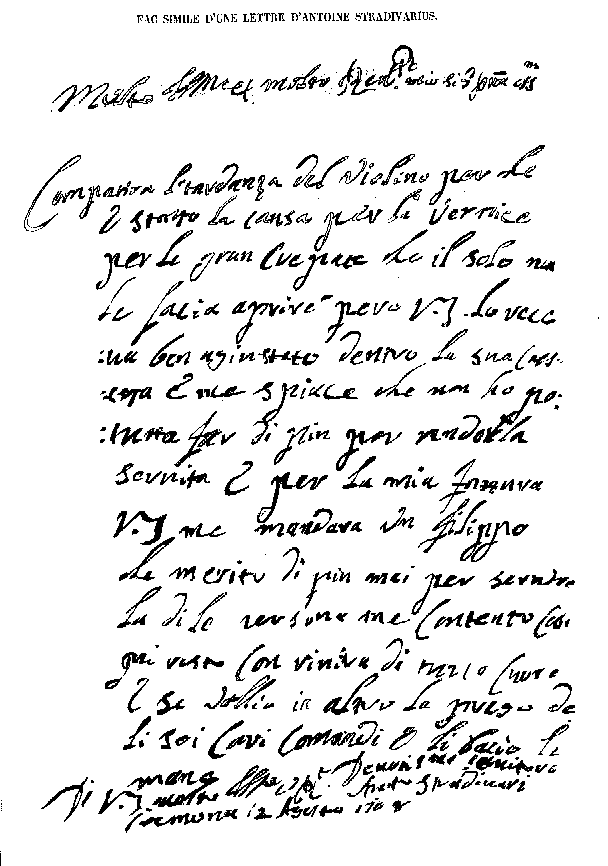
ANTOINE STRADIVARI
LUTHIER CÉLÈBRE
CONNUT SOUS LE NOM DE
STRADIVARIUS
PRÉCÉDÉ DE
RECHERCHES HISTORIQUES ET CRITIQUES
SUR L'ORIGINE, ET LES TRANSFORMATION,
DES INSTRUMENTS A ARCHET
ET SUIVI
D'ANALYSES THÉORIQUES SUR L'ARCHET
Et sur François TOURTE
Auteur de ses derniers perfectionnements.
PAR F. J. FÉTIS
Maître de chapelle du roi des Belges, et Directeur du Conservatoire de Bruxelles.
PARIS
VUILLAUME, LUTHIER
RUE DEMOURS, N° 3, AUX THERNES.
1856
Les droits de traduction et de reproduction sont réserves
A. Monsieur le Comte
César de Castelbarco,
Membre correspondant de l’Institut de France,
Chambellan Conseiller intime de l’Empereur de l’Autriche,
Chevalier de la première classe de l’Ordre Piano 25 eme
L’auteur
AVANT-PROPOS.
---------------
Passionné pour son art, comme l'est tout homme d'une valeur réelle, M. VUILLAUME s’est épris d'une admiration, portée presque jusqu'au culte, pour Antoine Stradivarius, ce luthier célèbre de Crémone dont la longue carrière a été consacrée tout entière à chercher et à réaliser la perfection dans la construction des instruments à archets . Après avoir employé une partie de sa vie à étudier les principes qui ont dirigé ce grand artiste dans ses travaux, M. VUILLAUME a voulu élever un monument à sa mémoire. Plusieurs voyages en Italie ont été faits par lui dans le seul but de recueillir les matériaux nécessaires. Quand il les eut rassemblés, il me les confia et me demanda ma coopération pour son oeuvre pieuse.
Bien qu’étranger à la nature habituelle de mes études, ce travail m'offrait beaucoup d'intérêt, comme tout ce qui tient à l’art auquel j'ai voué ma vie. Éclairé par l'expérience de M. VUILLAUME, j'ai pu me rendre assez familier le côté technique de la fabrication des instruments à Archet pour en parler, j'espère, avec clarté. C'est là, sauf ce qui concerne l’origine même de ces mêmes instruments, tout ce qui m’appartient dans ce petit ouvrage.
FETIS.
Bruxelles, le 8 mai 1856.
TABLE DES MATIÈRES.
Fac-Similé d’une lettre d’Antoine Stradivarius...........................................iv
Dédicace..................................................................................................... vij
Avant-propos .....................................................................................ix
Antoine Stradivari connu sous le nom de Stradivarius, luthier
célèbre. Ses prédécesseurs, ses contemporains et ses élèves ......................1
Recherches historiques sur l'origine et la transformation des
Instruments à archets ......................................................................3
Lutliers des écoles italiennes depuis les premiers temps............................50
Antoine Stradivarius. Perfectionnements des instruments à archets..........65
Les Guarneri ou Guarnerius.....................................................................106
L’archet de François Tourte.....................................................................113
Détermination empirique de la forme des archets de Tourte...................125
Fin de la table.
ANTOINE STRADIVARI
CONNU SOUS LE NOM DE
STRADIVARIUS
LUTHIER CÉLÈBRE
SES PRÉDÉCESSEURS, SES CONTEMPORAINS ET SES ÉLÈVES.
L'Italie, terre féconde en grandes et belles choses ; l'Italie, qui devanca toutes les nations de l'Europe dans la civilisation ; l'Italie, enfin, à qui furent donnés tous les genres de gloire, dans la poésie, la philosophie, les sciences et les arts ; l'Italie, dis-je, a vu naître les artistes qui ont porté au plus haut degré la perfection dans l'art de fabriquer les instruments de musique à archet. Dès le milieu du quinzième siècle, cet art y était déjà cultivé avec succès. D'où était-il venu? Par quelles causes de progrès s'est-il développé jusqu'à ce qu'il eût atteint ses dernières limites entre les mains d'Antoine Stradivarius et de Joseph Guarnerius surnommé del Jesu? Pourquoi s'est-il amoindri chez leurs successeurs ? Telles sont les questions que je me propose d'examiner avec soin dans cet écrit, et dont j'espère donner la solution, au point de vue de l'histoire ainsi qu'à celui de la théorie.
RECHERCHES HISTORIQUES
SUR L'ORIGINE ET LES TRANSFORMATIONS
DES INSTRUMENTS A ARCHET.
Quelle est l'origine des instruments à archet ? Problème d'archéologie qui a préoccupé plusieurs savants, sans qu'on en ait donné une solution satisfaisante. Quelques expressions obscures, dont on a forcé le sens, ont fait croire que les Grecs et les Romains avaient parmi leurs organes de musique quelque chose qui ressemblait à la viole. On a cru reconnaître cet instrument dans le magadis, dont le nom vient de magas (chevalet), parce que rien de semblable au chevalet ne paraît dans les lyres et les cithares. Le magadis était monté de vingt cordes, ou de vingt et une, suivant ce que rapporte Athénée, ou de vingt-deux, d'après Pausanias. Jean-Baptiste Doni croit qu'il a pu avoir quelque analogie avec la viola diBordone, autrement dite lirone, qui était en usage en Italie au seizième siècle, et dont les onze ou douze cordes servaient à faire des arpèges avec l'archet, ou de l'harmonie à plusieurs parties. Ces conjectures n'ont pas de valeur historique, car aucun passage des écrivains de l'antiquité ne les appuie ; aucun monument ne nous présente chez les Grecs un instrument à manche et à chevalet.
On a voulu voir l'archet dans le plectre ; mais plhctron, vient de plñctein, frapper. Il est vrai que les lexiques l'expliquent par archet d’un instrument de musique ; mais c'est par confusion dans la signification réelle du mot. Les statues, les bas-reliefs et les peintures des vases grecs nous offrent en très grand nombre des représentations du plectre, et dans toutes nous voyons un morceau de bois, d'os ou d'ivoire, terminé par des crochets, pour pincer les cordes, ou pour les battre avec le dos. Si les Grecs avaient voulu parler de l'archet véritable, dont les crins servent à frotter les cordes pour les mettre en vibration, ils l'auraient appelé toxάrίon, petit arc. Rien de semblable à l'archet ne paraît dans ce qui est parvenu jusqu'à nous de la sculpture et de la peinture des Grecs et des Romains.
La contrée qui nous offre les monuments les plus antiques d'une langue parfaite, d'une civilisation avancée, d'une philosophie où toutes les directions de la pensée humaine ont leur expression, d'une poésie immensément riche en tout genre, et d'une musique, organe de la sensibilité excessive des habitants, l'Inde parait avoir vu naître les instruments à archet et les avoir fait connaître à d'autres parties de l'Asie, puis à l'Europe. Là il n'y a pas de conjecture à faire, car les instruments existent. ils conservent encore les caractères de leur originalité native. Si l'on veut trouver l'instrument à archet dans son origine, il faut le prendre dans sa forme la Plus simple, et dans ce qui n'a pas exigé le secours d'un art perfectionné. Nous le trouvons dans le ravanastron, composé d'un cylindre de bois de sycomore creusé de part en part. Ce cylindre est long de 11 centimètres, et son diamètre est de 5 centimètres. Sur un de ses côtés est tendue une peau de serpent boa à écailles larges, qui est la table d'harmonie. Le cylindre est traversé de part en part, au tiers de sa longueur, vers la table, par une tige qui sert de manche, longue de 55 centimètres, arrondie dans sa partie inférieure, plate dans le haut et légèrement renversée. Cette tige est en bois de sapan. La tête de ce manche est percée de deux trous de 12 millimètres de diamètre pour les chevilles, non sur le côté, mais dans le plan même de la table. Deux grandes chevilles, longues de 10 centimètres, taillées en hexagone vers la tête, et arrondies à l'extrémité fixée dans les trous, servent à tendre deux cordes d'intestins de gazelle, lesquelles sont fixées à une lanière de peau de serpent attachée au bout inférieur de la tige. Un petit chevalet, long de 18 millimètres, taillé en biseau dans le haut, plat dans la partie qui pose sur la table, évidée rectangulairement dans cette partie, de manière à former deux pieds séparés : tel est le support des cordes. A l'égard de l'archet, il est formé d'un bambou mince, légèrement courbé en arc dans sa partie supérieure et droit dans l'inférieure. Un creux taillé dans la tête jusqu'au premier nœud sert à fixer une mèche de crins, qui est tendue et fixée à l'autre extrémité par vingt tours d'une tresse de joncs très flexibles.
Tel est l'instrument primitif à archet, maintenant abandonné au peuple de la dernière classe et à de pauvres moines bouddhistes qui vont, de porte en porte, demander l'aumône. Le son en est doux et sourd. D'après les traditions de l'Inde il a été inventé par Ravana, roi de Ceylan, cinq mille ans avant l'ère chrétienne.
D'autres instruments, faits à l'imitation du ravanastron, sont connus parmi les classes pauvres de l'Indoustan. Le premier, qu'on peut considérer comme la basse de celui-là, est aussi formé d'un cylindre en bois de sycomore long de 16 centimètres, ayant 11 centimètres de diamètre, et creusé dans toute sa longueur, de telle sorte que l’épaisseur de ce corps sonore n'a pas plus de 3 millimètres. Ce corps est traversé de part en part par une tige dont la longueur totale est de 86 centimètres, et qui forme le manche, comme dans le ravanastron. Cette tige est elle-même creusée verticalement à sa base, de manière à pouvoir y faire pénétrer jusqu'au bout un petit cylindre en bois de fer, de 9 centimètres de longueur, terminé par un bouton dans lequel est passée une lanière de cuir de chacal à laquelle on attache les cordes. La table est formée d'une légère planche de bois de mounah, qui a de la ressemblance avec le sapin par ses fibres longitudinales. L'instrument, appelé rouana, est monté de deux cordes, comme le ravanastron, et dans tout le reste il est semblable à celui-ci.
A une époque sans doute postérieure à l'invention des deux instruments dont il vient d'être parlé appartient l'omerti, autre instrument à archet, monté de deux cordes, dans lequel on aperçoit quelque progrès de fabrication. Le corps est formé d'une noix de coco dont on a enlevé le tiers, dont on a aminci les parois jusqu'à l'épaisseur de 2 millimètres, et qu'on a polie intérieurement et extérieurement. Quatre ouvertures elliptiques et une autre dans la forme d'un losange sont pratiquées à la partie antérieure du corps pour servir d’ouïes. Je possède deux de ces instruments ; dans l'un d'eux, la table est formée d'une peau de gazelle bien préparée et très unie ; dans l'autre, cette table est une planchette de bois satiné à maille très fine, de 1 millimètre d'épaisseur. Dans les deux instruments la largeur de cette table, au plus grand diamètre, est de 0, 05, 15. Comme dans le ravanastron et le rouana, le manche est formé d'une tige en sapan (bois rouge, de l'Inde) qui traverse le corps de l'instrument. La partie inférieure est arrondie forée longitudinalement à sa base pour y introduire un cylindre terminé par un bouton comme dans le rouana. Ce bouton est un petit cube percé d'un trou, où les cordes sont attachées. Le manche est aplati dans sa partie supérieure, et se termine par une tête renversée, coupée à angles droits. Les chevilles ne sont pas placées sur cette tête mais toutes deux à gauche du manche, et la tête est percée de part en part par une ouverture longitudinale de 6 centimètres de longueur et de 12 millimètres de largeur, pour introduire les cordes dans les trous des chevilles : c'est un commencement de la volute. Enfin, au bas de l'ouverture est un petit sillet en ivoire, haut de 1 millimètre, sur lequel les cordes sont appuyées. Le chevalet, sur lequel elles passent à l'autre extrémité, est exactement semblable à celui du ravanastron. L'archet, plus long que celui de ce dernier instrument, est fait aussi d'un léger bambou qui forme l'arc. A son extrémité supérieure est une fente dans laquelle la mèche de crins est fixée ; mais, au lieu d'être attachée par un lien en jonc à l'autre extrémité, cette mèche traverse le bambou par un trou et y est arrêtée par un nœud.
Si nous comparons l'ormerti à l'instrument arabe appelé kemângch à gouz (de kemân archet, et de kàh, qui se prononce guiah, lieu, c'est-à-dire lieu de l’archet, ou instrument à archet), nous reconnaîtrons immédiatement que l'instrument de l'Inde a fourni le modèle de celui de, l'Arabie. L'expression à gouz signifie vieille ; d'où, il suit que kemangch à gouz répond à vieil instrument à archet, ou instrument à archet primitif. Les lexiques traduisent ‘aﻲﮎ’, kemângch, par viole.. Villoteau remarque que ce mot est persan (Description historique, technique et littéraire des instruments de musique des orientaux, dans la grande Description de l’Egypte t. XIII, p. 290 de l'édition in-8°) ; or, la Perse ancienne touchait à l'Inde par l'est, et les rapports de ces deux grandes contrées se montrent partout dans l'histoire. Je viens de dire qu'il est impossible de méconnaître l'omerti dans la kemângch à gouz ; il suffit en effet de jeter les yeux sur celle-ci pour re connaître leur identité. Le corps de l'instrument, dans l'un comme dans l'autre, est une noix de coco dont on a retranché le tiers ; des ouvertures ;sont percées dans le corps de la kemângch, comme dans l'omerti, pour mettre en communication l’air extérieur avec celui qui est contenu dans l'instrument ; la seule différence est que ces ouvertures sont petites, en très grand nombre, et rangées symétriquement dans l'instrument arabe, . Dans celui-ci, comme dans l'autre, la table d'harmonie est une peau fine collée sur les bords de la noix de coco. Le manche est une tige cylindrique en bois de courbary, terminée dans sa partie inférieure par une large virole d'ivoire. Cette tige, depuis le corps de l'instrument jusqu'à la naissance de la tête, est longue de 66 centimètres. La tête, creusée comme celle de l'omerti pour y placer deux chevilles, est faite d'un seul morceau d'ivoire haut de 20 centimètres. Au lieu d'être toutes deux, sur le côté gauche, comme dans l'instrument de l'Inde, une des chevilles est à droite de la tête, l'autre à gauche, . La tige du manche, forée longitudinalement, reçoit un cylindre de fer qui traverse le corps de l'instrument, et qui, au lieu d'être terminé par un bouton, comme dans l'omerti, se prolonge extérieurement pour former un pied de 25 centimètres de longueur. A ce pied est un crochet auquel s'arrête l'anneau qui sert de cordier. Dans la description de cet instrument, Villoteau parle de la touche (Description historique, technique et littéraire des instruments de musique des orientaux', dans la grande Description de l'Égypte, t. XIII, p. 290 de l'édition in-8°) ; il n'y a rien de semblable sur la kemângh à gouz qui est dans ma collection c'est le manche cylindrique même qui sert de touche, comme dans l'omerti. Les cordes sont la partie la plus curieuse de cet instrument, car elles sont formées chacune d'une mèche de crins noirs fortement tendue. L'archet est composé d'une baguette de figuier-sycomore, façonnée au tour et courbée en arc, à laquelle est attachée et tendue me mèche des mêmes crins.
Les instruments dont on vient de voir la description ne sont pas, à proprement parler, dans le domaine de l'art ; ils appartiennent à la musique primitive et populaire, expression instinctive d’un sentiment qui, partout, a précédé l'art véritable. On doit ranger dans la même catégorie, et comme des variétés, certains autres instruments, faits d'après le même principe et dont la diversité de formes paraît n'avoir eu d'autres causes que la fantaisie, Tel est le rebâb des Arabes, qui n'entre dans aucune combinaison d'instruments dont se forment les concerts dans les contrées orientales, et qui n'a d'autre destination que de guider la voix des poètes et des conteurs dans leurs récitations chantées. Le corps du rebâb est formé de quatre éclisses sur lesquelles sont tendus deux parchemins qui forment la table et le dos. Cet ensemble présente l'aspect d'un trapézoïde dont le sommet est parallèle à la base, et dont les côtés sont à peu près égaux. Le manche est cylindrique et ne fait qu'une seule pièce avec la tête. Le pied est une tige de fer fixée dans le manche, laquelle traverse l'instrument. Le rebâb se pose sur ce pied, comme la kemangch à gouz. Il y a deux sortes de rebâb, qui ont tous deux la même forme : le premier, appelé rebâb de poëte, n'a qu'une corde ; l'autre, qui en a deux, est nommé, rebâb de chanteur. A vrai dire, le rebâb n'est qu'une modification du rouana de l'Inde, modification qui ne consiste que dans la forme du corps de l'instrument. Le rebâb n'appartient pas à la musique proprement dite ; ce n'est que l'usage originaire de la corde frottée par l'archet pour le soutien de la voix chantante.
Transportons-nous maintenant en Europe ; examinons-y les plus anciens monuments et les premiers renseignements recueillis sur les instruments à archet : nous y retrouverons les mêmes rudiments de ce genre d'instruments. Rien dans l'Occident qui ne vienne de l'Orient. En plusieurs endroits de mes écrits- j'ai dit et répété cette vérité, et j'ai cru n'y trouver autrefois qu'une seule exception pour l'archet, dont j'avais aperçu l’origine dans le goudok des Paysans russes Voy. mon Résumé philosophique de l'histoire de la musique, en tète du 1er volume de la Biographie universelle des Musiciens, p CXXIX, 1re édition) ; mais alors l’inde, au point de vue de la musique, ne m’était connue que d’une manière fort imparfaite. Les circonstances favorables qui, dans l’espace de vingt ans, m’ont permis de pénétrer au fond des doctrines antiques de la musique de ce pays, et m'ont rendu possesseur d'une partie des instruments qui en sont originaires, ces circonstances, dis-je, m'ont éclairé. Aujourd'hui sans aucune restriction, je répète encore : Rien dans l'occident qui ne vienne de l’Orient. Le goudok, avec ses trois cordes, sa volute, sa touche placée sur le manche, sa caisse sonore régulièrement construite, ses ouies dans la table d'harmonie, son chevalet proportionné à la longueur des cordes, son cordier semblable à celui de, nos violons, est une viole déjà perfectionnée, et ne ressemble pas à un essai primitif. Le goudok tire aussi son origine de l'Orient.
Aucunes traces de l'existence des instruments à archet n'apparaissent sur le continent européen avant la fin du huitième siècle ou le commencement du neuvième ; mais un poëte, Venance Fortunat, évêque de Poitiers, mort vers 609, et qu'on croit avoir composé ses poëmes élégiaques vers 570, nous dit que le crwth ou crouth des bardes gaëls, ou gallois était alors connu, et qu'il existait vraisemblablement en Angleterre longtemps auparavant. Le poëte rend ce nom barbare par chrotta dans ces vers :
Romanusque lyra plaudat tibi, Barbarus liarpa,
Graecus achilliaca, chrotta Britanna canat (1).
« Le Romain t'applaudit sur la lyre, le Grec te chante avec la cithare, le Barbare avec la harpe et le crouth breton » Ces vers, adressés au duc de Champagne, Loup, ami de Fortunat (Carmb. 8, lib. vii), sont empreints de l'exagération poétique habituelle de ces temps barbares. J’ignore ce qui a déterminé du Cange à substituer placet à canat dans la citation de ces vers (Gloss. act script. mediae et infim. aetatis, voc. Chrotta). Il corrige une faute de quantité dans le premier vers en le donnant de cette manière :
Romanus lyra plaudat tibi, Barbarus harpa.
Rien n'est plus plaisant que la note du jésuite Brouwer, éditeur des oeuvres de Venance Fortunat, sur le mot chrotta (Notae diversae, p. 186), qui, dit-il, a une affinité évidente avec crotale. Toutefois il pense que l'instrument dont il s’agit devait avoir de la ressemblance avec, l'écaille de la tortue, dont le nom, en ancien allemand, était crotte ou krote, d'ou est venu le nom du bouclier en forme de tortue, schildkkrote !
Les Saxons s'étaient emparés d'une partie de l'Angleterre dès 449, c'est-à-dire plus d'un siècle avant l'époque où Venance Fortunat composa ses poésies. On sait qu'ils policèrent la partie de la Grande-Bretagne qui leur fut soumise ; car leurs prédécesseurs les Romains n'y furent que campés. Peut-être pourrait-on supposer que l'usage d'un instrument à archet fut introduit par eux chez les Bretons ; mais il ne faut pas oublier que jamais le pays de Galles ne fut soumis à la domination saxonne, et que le crouth, dont l'usage paraît avoir été réservé aux descendants des Celtes, semble avoir été longtemps inconnu aux autres populations de l'Angleterre. Le nom de l'instrument est évidemment celtique., et l'orthographe originaire de ce nom (crwth) ne peut appartenir à une autre langue qu'à la gaélique. Or, le w gallois avec l'accent a exactement ; le son de la voyelle ? ? de la langue sanscrite. Édouard Jones, barde du prince de Galles, remarque que crouth, ou crowd, est une altération anglaise du mot primitif, d’où est venu crowther ou crowder, pour joueur de crouth (Voy. A Dissertation of the musical instruments of the welsh, p 114, n 2. Le nom gallois de l'instrument (crwth) vient du celtique primitif cruisigh, (musique), qui tire lui-même son origine du sanscrit krus' (crier, produire des sons puissants), dont la racine est kur (rendre un son) (cette étymologie parait inattaquable. (Vôy. Pictet, de l'Affinité des langues celtiques avec le sanscrit, p. 21 et 64.) Quant à celle que propose Édouard Joncs (loc. cit.), en faisant venir crwtlz de croth, qui, dans la langue gaélique, signifie le gras de la jambe, la matrice, et aussi un vase à contenir de l'eau, et qui rapproche ce mot du syriaque cruth, et du grec -xpocrebç, dont la signification est la même, j'avoue que je ne comprends pas l'analogie, .
Les Gaëls Kymris, qui peuplèrent originairement la Kymbery ou Caiïzbria, , aujourd'hui le pays de Galles, étaient une colonie celtique sortie de la Gaule ; car Gaels, Galli, Gaulois et Gallois ne sont qu'une seule et même chose, un seul et même peuple. Le gaélique, qu'ils parlaient et parlent encore dans les montagnes, est peu différent du dialecte de la langue celtique en usage chez les Bas-Bretons de France. Or, en l'état actuel des connaissances ethnographiques, l'origine indo-germanique des Celtes n'est plus contestée. A des époques antérieures à toute histoire. et par de lentes migrations, les races européennes se sont avancées de l'Inde par la.Bactriane, la Perse l'Arabie, l'Arménie puis, après voir franchi l'Hellespont (les Dardanelles actuelles)ont envahi les vastes contrées connues aujourd’hui sous les noms de Roumélie, de Transylvanie, de Valachie, de Servie, d'Esclavonie, de Croatie, de Hongrie, de Styrie et de Bohême. Plus tard, poussées par d'autres populations venues par les mêmes voies, elles ont abandonné ces stations pour se disperser en diverses directions, franchissant les grands fleuves, tels que le Danube, l'Elbe, le Rhin, la Saône, la Creuse ; peuplant enfin, par un de leurs rameaux, toutes les Gaules sous le nom de Celtes, et se subdivisant en une infinité de tribus perpétuellement en guerre les unes contre les autres. Ce n'est point ici le lieu où peuvent être exposées les indications plus ou moins probantes, plus ou moins certaines de ces filiations ; quelques savants de premier ordre se sont acquittés de cette tâche d'une manière toute spéciale dans ces derniers temps. La linguistique a porté son flambeau dans ces questions, et a triomphé de l'incrédulité la plus obstinée. La musique, expression universelle des affections de l'âme, peut aussi fournir ses preuves auxiliaires, comme je le ferai voir ailleurs. Dans le sujet qui m'occupe, il ne, s'agit que de retrouver les analogies d'instruments à archet de l'Occident avec le type primitif que nous avons vu dans l'Inde, puis d'en constater les transformations et les progrès.
Une question se présente ici : le crouth, dont nous ferons connaître tout à l'heure les deux formes, est-il, comme le prétendent quelques antiquaires anglais ou gallois, notamment le barde Edouard Jones, un instrument inventé par les Bretons, ou simplement le perfectionnement d’un modèle grossier ? Au premier aspect, le problème parait résolu par l’expression de Venance Fortunat, chrotta Britanna (le crouth breton) ; mais, outre qu’il y a en France des Bretons, des Gaëls, commeen Angleterre, il y a une objection péremptoire pour faire rejeter la création, de prime abord, d'un instrument tel que le crouth, même dans sa forme la plus simple ; car l'idée d'une caisse sonore composée d'une table d'harmonie, d'une table postérieure et d'éclisses avec un manche, plusieurs cordes élevées par un chevalet et attachées par des chevilles de fer au revers de la tète ; l'idée, dis-je, d'un tel instrument ne peut être primitive. On comprend l'invention du ravanastron de l'Inde, parce que ce type grossier peut être l'ouvrage du premier venu à qui le hasard aura appris qu'une mèche de coton tressée, un morceau de bois, une tige métallique, produisent des sons lorsqu'on les frotte avec des crins de cheval ; mais on ne peut croire qu'un instrument dont la fabrication exige le talent d'un luthier ait été imaginé comme essai dans un temps de barbarie. Toute porte donc à croire que, dans ses migrations, la race indo-celte a transporté le modèle informe de l'appareil à cordes frottées, dont les derniers perfectionnements nous charment aujourd'hui sous les doigts des virtuoses. Le principe de la production des sons par l'action de l'archet aurait pu naître sans doute en divers lieux ; mais il n'a pu créer tout à coup des instruments réguliers chez un peuple peu avancé, qui vivait sous un climat rude, tandis que son origine n'est marquée dans l'Inde que par de timides essais. Les affinités si remarquables du sanscrit et des dialectes celtiques sont des indices certains des rapports primitifs de ces nations placées à de si grandes distances.
Quoi qu'il en soit, il y eut deux sortes de crouth, lesquelles appartiennent à des époques différentes. Le plus ancien de ces instruments est le crouth trithant, c'est-à-dire le crouth à trois cordes : il est vraisemblable que c'est celui-là dont parle Venance Fortunat. Peut-être même ce crouth primitif n'avait-il que deux cordes, comme en eurent encore longtemps après d'autres instruments dont il sera parlé plus loin. Un manuscrit du onzième siècle, qui provient de l'abbaye de Saint-.Martial de Limoges, et qui est à la Bibliothèque impériale, sous le n° 1118 des manuscrits latins, contient quelques figures d'instruments grossièrement dessinées, parmi lesquelles il s'en trouve une qui représente un personnage couronné, lequel tient de la main gauche un croutli à trois cordes, qu'il joue avec l'archet, de la main droite. Voici cette figure :
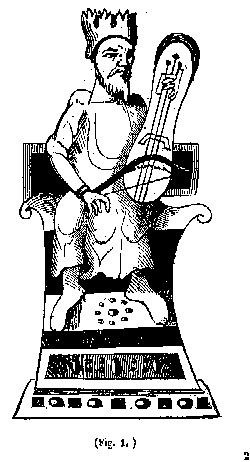
L'instrument se reconnaît à l'échancrure, par ou passe la main pour poser les doigts sur les cordes. Une autre représentation du crouth trithant se voit parmi les ornements extérieurs de l'abbaye de Melross, en Écosse, qui fut bâtie dans les premières années du quatorzième siècle, sous le règne d'Édouard Il : il était donc encore en usage à cette époque.
Le 3 mai 1770, Daines Barrington, alors juge des comtés de Caernarvon et d'Anglesey, dans le pays de Galles, lut à la Société des Antiquaires de Londres, dont il était membre, des notes sur deux instruments en usage dans ce même pays (le crouth et le pib-corn) ; elles furent publiées dans le troisième volume de l'Archéologie( Archaeologia, or Miscellaneous tracts relating to antiquity, published by the Society of the Antiquaries of London, T iii (1775, p 32), avec une planche qui représente les deux instruments dans des dimensions assez grandes pour en faire comprendre les détails. Bien qu'un peu trop sommaires, les notes de Daines Barrington ont de l'intérêt, parce que non-seulement il avait vu les instruments dont il parle, mais parce qu'il avait entendu jouer le crouth par John Morgan, né dans l'île d'Anglesey en 1711, alors âgé de cinquante-neuf ans, et qui paraissait devoir être le dernier barde dont les mains auraient touché cet instrument, devenu d'une rareté excessive. La figure du crouth donnée par Daines Barrington a été dessinée d'après l'instrument. Bottée de Toulmont en a fait faire une très mauvaise copie, qui donne des notions fausses de la construction du crouth, pour sa Dissertation sur les instruments de musique employés au moyen age (Dans le XVIIe volume des Mémoires de la Société royale des Antiquaires de France). M. Coussemaker a fait plus reproduisant la mauvaise figure de Bottée de Toulmont, au lieu de recourir à l'Archaeologia, il écrit au-dessous de cette nouvelle copie crouth à six cordes. - Mss. du XIe siècle (Essai sur les instruments de musique du moyen age, dans les Annales archéologiques, publiées par Didron aîné, t. 111, p. 150.). Or, il n'est question ni de manuscrit, puisque la figure a été dessinée d'après nature, ni de onzième siècle, car il s'agit d'un instrument relativement moderne et perfectionné qui existait vers la fin du dix-huitième siècle. Cette méprise est comme si l'on présentait la harpe à trois rangs de cordes des bardes actuels du Caernarvon et du Merioneth pour celle du sixième siècle, dont parle Venance Fortunat.
Déterminer l'époque où le crouth à six cordes a succédé au crouth trithant serait impossible ; car aucun renseignement positif sur ce sujet n'a été découvert jusqu'à ce jour («Nous n'avons pas, dit M. Bingley (North Wales, including its scenery, antiquities, customs, etc., t. II, p. 332) de renseignements authentiques, concernant le crwth d'une date plus ancienne que le quinzième siècle (We have no authentic infomation respectinq the crwth of more ancient date than th efifteenth century). -
Le renseignement dont parle ce savant est sans doute la description de l'instrument à six cordes par le barde gallois Gruffydd Davydd ab Howel, qui vivait en effet dans le quinzième siècle, et dont voici l’original, suivi d'une traduction d'après la version anglaise d'Édouard Jones (loc. cit., P. 115) :
Crwth.
Prennol t'eg bwa a gwregis
Pont a bran, pont yw ci bris ;
A thalaith ar waith olwyn,
A'r bwa ar draws byr ei drwyti
Ac e'i ganol mac dolen,
A gwàr hwa megis gwr liên
Ac ar ci vrest gy*air vrég,
O'r Masarn vo geir Miwsig,
Chwe yspigod o's codwn,
A dynna hell dannau liwa ;
Chwe 'tirant a good o vantais,
Ac yn y Ilaw yn guri Ilais ;
Tatit i bôb b'ys ysbvs cedd,
A dati-dant i'r vawd ydoedd.
Le crouth.
Un joli coffre (sonore) avec un archet, un lien, une touche, un chevalet ; sa valeur est d'une livre. Il a la tête arrondie comme la courbe d'une roue, et perpendiculaire à l'archet au petit crochet ; et de son centre sortent les accents plaintifs du son ; et le renflement de son dos est semblable à celui d'un vieillard ; et sur sa poitrine règne l'harmonie. Dans le sycomore nous trouvons la musique. Six chevilles, lorsque nous les vissons, tendent les cordes ; et ces six cordes sont ingénieusement imaginées pour produire cent sons sous l'action de la main ; une corde pour chaque doigt est vue distinctement, et les deux autres sont pour le pouce. »
Ainsi qu'on le voit dans cette description, le dos du crouth était voûté ; détail qui n'est pas rendu dans les dessins de Daines Barrington et de Jones.)
Le premier n'avait pas cessé d'exister quand l'autre a été adopté, puisque le barde Édouard Jones nous apprend qu'il était moins estimé, parce qu'il ne pouvait produire une harmonie aussi complète (The performers, or Minstrels of this instrument were not in the a same estimation and respect as the Bards of the Harp and Crwth, bccause the three stringed crwth did net admit of equal skill and harmony, etc. - À Dissert. on the musical instruments of the Wels, , p. 116.). L'excellente construction du crouth à six cordes, que le même Jones et Daines Barrington nous ont fait connaître, démontre que l'art de la lutherie avait fait de grands progrès chez les Gallois lorsqu'ils ont été fabriqués. Ces instruments ont la forme d'un trapézoïde allongé, dont la longueur, du sommet à la base, est de 57 centimètres ; la plus grande largeur, près du cordier, est de 27 centimètres, et la plus petite, au sommet du trapèze, est de 23 centimètres. L'épaisseur de la caisse sonore, composée de deux tables de sycomore et d'éclisses, est de 5 centimètres, et la longueur de la touche est de 28 centimètres. Des six cordes dont l'instrument est monté, deux sont en dehors de la touche : elles sont pincées à vide par le pouce de la main gauche ; les quatre autres, placées sur la touche, se jouaient avec l'archet. Ces cordes sont attachées par leur extrémité inférieure au cordier, lequel est fixé de la même manière que dans les anciennes violes ou quintons. Dans certains instruments, par exemple dans celui dont Daines Barrington a donné là figure, ce cordier offre, au point d'attache des cordes, une ligne droite et parallèle à la base du crouth (voyez la figure n° 2) ; mais dans d'autres, suivant la figure donnée par Jones (1), ce cordier a la direction oblique qu'on remarque dans celui de la viole bâtarde à six cordes, dont il sera parlé plus loin. L'extrémité supérieure des cordes passe par des trous percés dans le massif du haut de l'instrument appuyant sur des sillets, et est attachée au revers de la tète par des chevilles, lesquelles se tournent, dit M. W. Bingley ( North Wales, including its scenery, antiquities, customs, etc., t. 11, P. 331.), avec une clef ou levier, à la manière de la guitare.
La table est percée par deux ouies rondes, dont le diamètre est de 3 centimètres. Le chevalet est la partie la plus singulière de l'instrument : on ne peut juger de sa forme par la figure qui accompagne les notes de Daines Barrington, parce que le dessinateur n'a pas su le mettre en perspective ; mais le dessin donné par Jones est satisfaisant à cet égard. Suivant le premier de ces auteurs, le chevalet du crouth est exactement plat ( The bridge of the crwth also is perfectly flat., (Loc. cit., p. 32.) W. Bingley dit la même chose (These (strings) are all supported by a bridge flat at the top, and not, as in the violin, convex. - (Loc. cit.). Édouard Jones n'est pas aussi affirmatif, car il dit seulement que le chevalet du crouth est moins convexe que celui du violon à sa partie supérieure («The bridge of this instrument differt from that of a violin, in being less convex at the top. » (A Dissert. of the musical instruments of the Welsh, p. 115.) toutefois, dans la figure qu'il en donne, le haut du chevalet présente une ligne droite. Il résulte de cette circonstance, et de ce que le corps de l'instrument n'avait pas d'échancrures pour le passage de l'archet, que celui-ci devait toucher plusieurs cordes à la fois, et conséquemment produire une harmonie quelconque, en raison du doigter. J'ai déjà fait cette remarque, en 1835, dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique (Voy. Biographie universelle des Musiciens, t. 1, p. cxxxvii.) ; depuis lors, M. Coussemaker (Essai sur les instruments de musique du moyen âge, dans les annuaires archéologiques de Didron, t. 111, p. 152.) l'a reproduite. Une autre particularité du chevalet du crouth lui donne beaucoup d'intérêt pour un observateur instruit : elle consiste dans l'inégalité de hauteur de ses pieds et dans sa position. Placé obliquement, en inclinant vers la. droite, il a le pied gauche long d'environ 7 centimètres. Ce pied entre dans l'intérieur de l'instrument par l'ouïe gauche, s'appuie sur le fond, et le pied droit, dont la hauteur est d'environ 2 centimètres, est appuyé sur la table, près de l'ouïe droite. Il résulte de cette disposition que le pied gauche remplit les fonctions de l'âme dans le violon, et qu'il ébranle à la fois la table, le fond et la masse d'air contenue dans l'instrument. Cette disposition, assez mal indiquée dans la figure donnée par Daines Barrington, a complètement disparu dans la mauvaise copie de Bottée de Toulmont et dans la reproduction de cette copie faîte par M. Coussemaker. Dans l'une comme dans l'autre la direction oblique du chevalet a disparu, aussi bien que l'inégalité de ses pieds et l'introduction du pied gauche dans l'ouïe. On n'y retrouve pas même l'indication du fond de l'instrument ; en sorte qu'il semble que la table d'harmonie est ajustée simplement sur des éclisses et que le crouth n’a pas de dos. La figure donnée par Édouard Jones (p. 89) est très exacte ; elle fait bien comprendre la position du pied gauche du chevalet, et la description qu'il en donne lève tous les doutes. La voici :
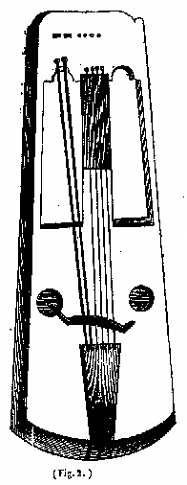
«Le chevalet n'est pas placé à angles droits avec les côtés du crouth, mais dans une direction oblique ; et, ce qui est à remarquer en outre, un des pieds du Chevalet sert aussi d'âme.
Il passe par une des ouïes, lesquelles sont circulaires, et s'appuie sur la table inférieure ; l'autre pied, plus court, est posé sur « la table près de l'autre ouïe (The bridge is not placed at right angles with the sides of the crwth, but in an oblique direction ; and, which is farther to be remarked, one of the feet of the bridge serves also for a sound post ; it goes through one of the sound-holes, which arc circular, and rests on the inside of the back, the other foot, which is proportionably shorter, rest on the belly before, he other sound hole. » (A Dissertation, etc., p. 115.)
Les six cordes du crouth sont accordées d'une manière originale. Voici cet accord :
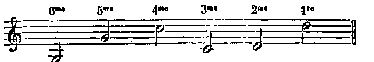
Cet accord n'a pas été choisi par caprice ; car il a pour objet de donner à vide des quintes et des octaves entre toutes les cordes, soit en pinçant les cinquième et sixième cordes, soit avec l'archet. Ces accords se formaient comme on le voit dans cette table
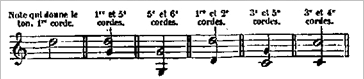
Il est remarquable que la sixième corde pincée à vide (sol) s'appelait vyridon dans la langue celtique, et que les cordes les plus graves des instruments à archet sur le continent européen, depuis le moyen âge jusque dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, ont été désignées par le nom de bourdon, qui est évidemment le même mot passé dans les langues romanes.
L'accord qu'on vient de voir est celui que donne Daines Barrington, d'après le barde John Morgan, qu'il avait entendu ayant 1770. Édouard Jones, dont l'intéressant ouvrage fut imprimé en 1784, donne aussi le même accord, qui toutefois pouvait varier en raison du ton et du caractère de la mélodie populaire qu'on voulait exécuter. Ainsi W. Bingley entendit en 1801 un vieux barde à Caernarvon qui jouait quelques airs anciens sur un crouth accordé de cette manière :
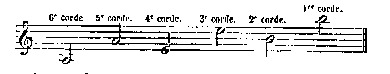
On voit dans la figure donnée par Daines Barrington que les grosseurs des cordes étaient proportionnées dans le crouth, comme dans nos instruments, en raison de leur intonation et de leur degré de tension. Ainsi les deux cordes longues placées en dehors du manche, et destinées à être pincées, étaient les plus grosses ; les cordes des notes ut, ré, graves, étaient moyennes, et celles des mêmes notes à l’aigu étaient minces. Ces distinctions ont disparu dans les copies publiées par Bottée de Toulmont et par Coussemaker.
Après ce qui vient d'être dit concernant le crwth, crowth, crouth, il reste à examiner cette question : Cet instrument a-t-il exercé quelque influence sur l'origine et les transformations des instruments à archet en usage sur le continent européen, particulièrement du violon ? en un mot, y a-t-il été connu ? En quel état y était-il au moyen âge ?
Les paroles de Venance Fortunat que nous avons rapportées prouvent que le crouth avait pénétré sur le continent dès le sixième siècle. De plus, la figure du manuscrit de Saint-Martial de Limoges démontre que le crouth primitif à trois cordes était en usage dans le midi de la France au onzième siècle. Cet usage s'est-il perpétué, et retrouve-t-on l'instrument dans les temps postérieurs ? Bottée de Toulmont a fait à ce sujet des conjectures exposées longuement (Dissertation sur les instruments de musique au moyen âge, p 32 et suiv) pour démontrer qu'un instrument appelé rotta, rota, et rothe, par quelques écrivains du moyen âge et par les trouvères, devait être la même chose que le crouth, dont le nom était altéré, et non, comme quelques-uns l'on cru, la -vielle, dont les sons se produisent par le frottement d'une roue, parce que le nom de celle-ci était symphonie, cifonie, ou chifonie. Bottée de Toulmont argumente d'un passage du commentaire de Notker, moine de Saint-Gall au dixième siècle, sur le symbole d'Athanase, passage rapporté par du Cange (Gloss. ad script. Med. Et infim, aetatis, ex edit. Henschelli, t. v, p 786 et seq., voc. Rocta.) ainsi que par Schilter (Thesaurus Antiq. Teuton., iii. Gloss. Teuton, voc. Rotta), et que ce pauvre Bottée n'entend pas, quoique le sens soit très clair. Il s'agit de l'ancien instrument appelé psaltérion, , qui était monté de dix cordes, avait la forme du ‘n’ grec, et qui, modifié dans sa forme et dans le nombre de ses cordes par les musiciens, a reçu le nom barbare de rotta (Sciendum est quod antiquum psalterium, instrumentum decachordum, utique erat, in hac videlicet deltae litterae figura multipliciter mystica, Sed postquam illud symphoniaci quidam et ludicratores, ut quidam ait, ad suum opus traxerant, formam utique ejus et riguram commoditati suae habilem fecerant, et plures chordas annectentes et nomine barbarico rottam appellantes, mysticam illam Trinitatis formam transmutando. ») On voit qu'il n'est pas question dans ce passage d'un instrument à archet, mais d'un instrument à cordes frappées ou pincées, tel qu'était l'ancien psaltérion ou psalterium. Il y a à cet égard un passage décisif dans la LXXXIXe lettre de saint Boniface, apôtre de l'Allemagne et archevêque de Mayence, qui vécut dans le huitième siècle, et périt dans l'accomplissement de sa mission apostolique, le 5 juin 755. «Je me réjouis (dit- il) d'avoir un cithariste qui puisse jouer de la Cithare, que nous appelons rotta (Delectat me quoque cytharistum habere qui possit cytharizare in cythara, quam nos appellamus Rottae (sic). - Epist. 89, ex edit. Serrarii). » La Rotta, rota, rote ou rothe était donc une cithare ; non la cithare antique, qui était une lyre dont on jouait en l'appuyant sur la partie supérieure de la poitrine (xLO@pa), mais la cithare teutonique, formée des modifications introduites dans la forme du psaltérion et dans le nombre de ses cordes. Ces modifications de la forme consistaient dans l'arrondissement des angles du delta ; et c'est de là précisément que lui venait son nom rota (instrumentum rotundum). Nous n'avons pas de conjectures à faire sur l'instrument en lui-même ni sur la manière d'en jouer ; car un manuscrit du commencement du septième siècle, qui existait autrefois dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Blaise, renfermait une figure de femme qui pince les cinq cordes d'une cithare teutonique ou rotta, lesquelles sont attachées à un cordier allongé et sont appuyées sur un chevalet. L'abbé Martin Gerbert a publié cette figure (De Cantu et Musica, t. II, tab. xxvi, fig. 3.). Une autre rotta, semblable à celle-ci pour la forme, sauf le chevalet, est montée de sept cordes ; elle est tirée d'un autre manuscrit du neuvième siècle ; l'abbé Gerbert l'a également fait graver (Ibid., tab. xxxii, fig. 17.). Je reconnais un instrument du même genre, c'est-à-dire une véritable rote, et non un crouth, dans une sculpture de la cathédrale d'Amiens, qui date du treizième siècle, car il ne s'y trouve pas de manche. De toute évidence les cordes de cet instrument étaient pincées ; c'était une cithare, une rote. On voit donc que l'érudition de Bottée de Toulmont est en défaut, et que la rote n'était pas un instrument à archet. M. Coussemaker, fidèle à son système d’emprunt, sans citer ceux qu’il copie, n’a pas la prudence conjecturale de son prédécesseur ; il en use sans façon, et s'exprime catégoriquement en ces termes : «Quoique principalement en usage chez les Bretons, le crout était d'origine barbare, et il a pris le nom de rota chez les poètes et les romanciers du moyen âge. Plusieurs auteurs ont pensé que le mot rote était donné à la vielle : c'est une erreur. Rota ou rotta ne dérive pas de rottare, mais bien de chrota, mot germanique dont on a supprimé le signe d'aspiration ch, comme on l'a fait dans beaucoup de noms qui avaient la même origine (Essai sur les instruments de musique du moyen age, dans les Annales archéologiques de Didron, t. 111, p. 152.). » Je ne suis entré dans ces détails que pour dissiper une erreur qui s'est accréditée chez les archéologues, lesquels se copient mutuellement, sans se donner la peine de vérifier. Si la rote est citée souvent par, les poètes et les écrivains avant ou après les instruments à archet, cela n'indique en aucune manière que ce soit un instrument du même genre. Autant 'vaudrait croire que la harpe était semblable à la viole ou vielle, parce qu'on trouve dans quelques vieux poèmes des passages tels que celui-ci :
Harpes sonnent et vielles,
Qui font les mélodies belles.
(Roman du Renard, au Xllle siècle.)
Le texte de saint Boniface est positif : la rote était une cithare, un instrument à cordes pincées. Nous voyons même, dans l'oeuvre d'un poète provençal du douzième siècle, que le nombre de ses cordes pouvait s'élever jusqu'à dix-sept :
E faits la rota
A.xvii cordas garnir.
Je ne puis admettre non plus l'opinion de l'érudit AI. Georges Kastner, que le nom de rote s'appliquait à deux instruments de nature différente, dont un aurait été joué avec l'archet, et l'autre en pinçant les cordes (Les Danses des Morts, dissertations et recherches historiques, philosophiques, littéraires musicales, p. 24 1.) Je ne connais pas un seul texte qui justifie cette conjecture.
Revenons à la part que le crouth trithant ou à trois cordes a pu avoir dans la formation des instruments à archet qui furent en usage sur le continent européen. M. Hersart de La Villemarqué a cru le retrouver dans les mains des barzou, bardes mendiants de la Bretagne ; car il dit : « Ils s'accompagnent des sons très peu harmonieux d'un instrument de musique à trois cordes, nommé rebek, que l'on touche avec un archet, et qui n'est autre que la krouz ou rote des bardes gallois et brettons du sixième siècle (Barzaz-Breiz, chants populaires de la Bretagne, introduction, p. xxxiv, 4e édition. Paris, 1846, 2 vol. in 12.).» On voit dans ce passage l'erreur qui concerne la rote reproduite d'après Bottée de Toulmont, et une autre qui appartient au savant éditeur des Chants populaires de la Bretagne, à savoir, la prétendue analogie qui aurait existé entre le rebek des poètes mendiants bas-bretons et le crouth des bardes gallois. Les formes de cet instrument sont essentiellement différentes ; car le crouth primitif a le corps déprimé vers le centre, et présente dans ses parties supérieure et inférieure des renflements hémisphériques égaux, ou à peu près, tandis que le rebec, violon populaire du continent (qui n'est autre que la rubèle ou rebelle du moyen âge, laquelle n'eut d'abord qu'une corde ou deux, comme le rébab populaire des Arabes), le rebec, dis-je, était étroitvers le manche, et s'élargissait progressivement en s'arrondissant vers son extrémité inférieure. Sa forme était celle d'une des petites variétés du luth, modifiée par un cordier plus ou moins allongé, par un chevalet et par l'archet qui mettait les cordes en vibration. La plus ancienne représentation d'un instrument de ce genre a été extraite par l'abbé Gerbert d'un manuscrit qui appartient au commencement du neuvième siècle : il n'est monté que d'une corde. Des ouïes semi-circulaires sont percées dans la table, et la corde est posée sur le chevalet ; une partie du manche parait plus élevée que la table. Voici cette figure, où l'on voit la main dirigeant l'archet sur la corde.
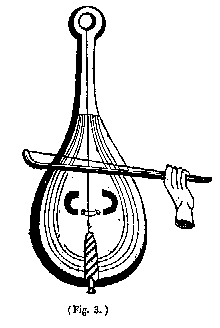
Dans les siècles suivants, les monuments nous offrent des représentations des instruments des deux genres, c'est-à-dire, ou dans la forme plus ou moins modifiée du crouth trithant, on dans celle qui se rapproche des variétés du luth. Les instruments de cette dernière espèce n'ont que deux ou trois cordes ; quand le peintre ou le sculpteur leur en donne quatre, c'est par inadvertance ; car il y a beaucoup d'inexactitudes, soit dans les représentations des instruments, soit dans la manière dont leurs noms sont écrits. La rubèbe appartenait à ce genre ; elle n'était montée que de deux cordes. Jérôme de Moravie, dominicain du treizième siècle, nous apprend que c'était un instrument grave, et que son accord était celui-ci (Dans le chapitre xv111e de la compilation de divers traités de musique dont le manuscrit est à la Bibliothèque impériale de Paris (fonds. de la Sorbonne, n° 1817, in-4°).1)
![]()
L'instrument aigu de la même espèce était monté de trois cordes ; on lui donnait en France le nom de gigue, dans les douzième, treizième et quatorzième siècles ; c'est au quinzième siècle que ce nom paraît changé pour la première fois en celui de rebec pour tous les instruments de la même famille, grands, moyens et petits. Les Allemands leur donnaient le nom de Geige ohne Bunde (violes sans ceinture, c'est-à-dire sans éclisses), pour les distinguer des autres instruments plus perfectionnés (voy. le livre de Martin Agricola intitule musica instrumentales (Wittenberg, 1829), fol lv et lvi. Gigue et Geige sont évidemment le même mot dans deux langues différentes.). En voici la
forme :
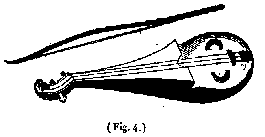
La rubèbe, la gigue, les quatre classes enfin du genre rebec qu'on trouve déjà établies dès le quinzième siècle, à savoir : dessus, alto, ténor et basse, sont des instruments populaires placés entre les mains des ménétriers) et qui servent en général pour la danse et pour les chanteurs des rues. Leur forme était invariablement celle qu'on vient de voir. Souvent la basse de ce genre d'instrument était jouée par le monocorde, ou par la trompette marine, dont le corps était un cône pentagone très allongé, sur lequel était appliquée une table d'harmonie en sapin. La corde unique de cet instrument, appuyée sur un chevalet dont les pieds étaient inégaux, était tendue par un tourniquet à ressort ; on formait les intonations avec le pouce de la main gauche. L'archet était un arc très bombé, avec une hausse large que le musicien serrait dans sa main droite renversée.
L'autre classe d'instruments à archet, qui consistait en une caisse sonore, formée de deux tables réunies par des côtés minces, appelés éclisses, lesquels étaient déprimés vers le milieu de leur Longueur, comme le corps de la guitare ; cette classe, dis-je, dont le type est dans le crouth trithant du sixième siècle, et qu'on désignait par les noms de vielle et de viole, appartient à un art plus perfectionné (ein ander Art, dit Agricola). C'est ainsi que, dans l'Inde, les sarungies, les saroh et les chikàra, à quatre et à cinq cordes de boyau, construits avec beaucoup d'élégance et de fini par Gun Pat et par Mahamdou, qui sont les Stradivarius et les Guarnérius de Bénarès, diffèrent essentiellement du ravanastron et de l'omerti, et appartiennent à un art plus élevé. C'est ainsi encore que les kemangeh roumy à quatre et à six cordes, en usage. dans la Perse, en Arabie, en Turquie et en Égypte, appartiennent à la musique cultivée comme art, tandis que les kemângeh à gouz, kemângeh fark, kemângeh soghair, et le rebab, montés chacun de deux cordes, sont abandonnés au peuple et n’exigent presque pas d'étude.
Dès la fin du onzième siècle, nous apercevons les vielles ou violes sur les monuments. Les plus anciennes représentations de cette espèce nous font voir ces instruments montés de quatre cordes. L' auteur d'un traité anonyme des instruments de musique, qui ne paraît pas pouvoir être postérieur au treizième siècle (De diveris monochordis, tetracordis, pentachordis, exachordis, eptachordis, octochordis, etc., ex quibus diversa formantur instrumenta musicae, cum figuris instrumentorum. Ce traité se trouve dans un recueil manuscrit de divers ouvrages sur la musique, lequel est à la bibliothèque d l'université de Gand, sous le no l7l ), attribue l'invention de la viole à quatre cordes à un certain, Abinus, et en donne une figure fort imparfaite. Invention ne peut être pris que pour modification. En quel temps vécut cet Albinus ? On ne le sait ; mais on trouve dans l'ouvrage dont il s'agit une indication précieuse sur l'accord des quatre cordes, qui sont représentées par les lettres a, d, g, c, lesquelles correspondent aux notes :
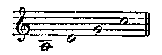
Cet accord par quartes se trouve dans les violes au seizième siècle ; cependant il a varié, comme on reverra tout à l'heure.
Au treizième siècle, beaucoup de violes ont cinq cordes dans les monuments qui les représentent ; telles sont celles aussi dont Jérôme de Moravie parle dans l'ouvrage cité précédemment. La forme de ces instruments est toujours celle de la guitare, et c'est cette même forme qu'on retrouve pendant tout le quatorzième siècle. L'absence du chevalet est la particularité la plus remarquable de ces figures, qui se présentent toutes sous cette forme :
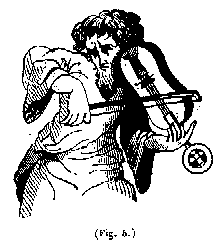
Dans le grand nombre de figures de violes ou vielles qu'on rencontre sur les monuments, dans les manuscrits, et même dans les ouvrages d'une date rapprochée de notre temps, tels que ceux de Martin Agricola (musica instrumentalis, deutsch, etc. Gedruckt zu Wittemberg durch Georg. Rhaw, 1529, pet. in-8°.) et d'Ottmar Luseinius ou Nachtgall (Musurgia seu Praxis musicae Illius primo quae instrumentis agitur certa ratio, etc. Argentorati, apud Johannem Schottum, 1536, pet. In 4° obl.), on remarque que les unes ont des chevalets, et que d'autres n'en ont pas, même à des époques identiques. Ainsi, trois figures de l'ancien portail de l'abbaye de Saint-Denis, qui fut construit dans le douzième siècle, représentent des violes à cinq cordes et à trois, qui ont des chevalets. Le portail de Notre-Dame de Chartres, qui est aussi du douzième siècle, présente dans ses sculptures une vielle à trois cordes avec un chevalet. D'autre part, une rubèbe à deux cordes, que tient un ange, dans un vitrail de l'abbaye de Bon-Port, en Normandie, appartenant au treizième siècle, n'a pas de chevalet.
Une viole à cinq cordes, qu'on voit dans un roman francais du quatorzième siècle (manuscrit no 6737 de la Bibliothèque impériale de Paris), a un chevalet ; mais un rebec à trois cordes, qu'on remarque dans le miroir historial de Vincent de Beauvais (mss. du quinzième siècle, n°, 6731 de la même bibliothèque), et une petite viole, également à trois cordes, qui se trouve dans un manuscrit de la Bible hstoriaux, de la même époque (no 6819 de la mêrne bibliothèque), n'en ont pas.
Une grande viole à quatre cordes, qu'une femme tient entre ses jambes, dans le livre intitulé les Échecs amoureux (mss du quinzième siècle, n° 6808 de la Bibl. impér.), a un chevalet. Il en est de même d'un petit rebec à trois cordes que tient une syrène dans le même volume. Ce rebec a la forme exacte de ceux qui sont représentés dans le livre de Martin Agricola(Musica instrum., etc, p lv, lvi). Enfin on voit un chevalet à la viole à quatre cordes qui se trouve dans le livre des Proverbes et Adages, du seizième siècle (mss no°4316, fonds de La Vallière, même bibliothèque). Cependant, à la même époque, deux hommes instruits (Ottmar Nachtgall et Martin Agricola), , qui ont traité spécialement la matière dont il s'agit, ont représenté, dans leurs ouvrages, des violes dont les cordes sont attachées à un cordier semblable à celui de la guitare, et sans chevalet, comme dans cette figure :
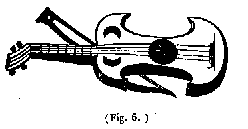
Or, il eût été absolument impossible que l'archet ne touchât pas ensemble toutes les cordes d'un instrument ainsi fait ; d'autre part, les sons qu'on aurait essayé d'en tirer auraient été d'une faiblesse excessive ; car c'est le chevalet qui fait faire aux cordes l'angle nécessaire pour qu'elles vibrent avec éclat, et pour qu'elles communiquent leur ébranlement à la table ; c'est enfin le chevalet qui, vibrant lui-même avec énergie, communique à la table, par ses battements précipités, les oscillations vibratoires d'où résulte l'intensité du son. N'oublions pas d'ailleurs que, dès son origine, le principe de la production des sons par le frottement de l'archet sur les cordes est accompagné de l'appendice nécessaire du chevalet. On le trouve dans le primitif essai du ravanastron, dans l'omerti, de l'Inde, dans le rebab et dans la kmângeh à gouz des Arabes, partout enfin où l'archet a pénétré. Il est donc hors de doute que l'absence du chevalet dans quelques monuments du moyen âge et dans les figures publiées par Agricola, ainsi que par Ottmar Nachtgall, n'a d'autre cause que des inadvertances ou des oublis de dessinateurs.
Nous en avons une preuve à l'égard de ce que nous voyons chez ces deux auteurs ; car leur contemporain, Silvestre Ganassi (lel FonteË-o, de qui l'on a un traité spécial de l'art de jouer de la viole (Regola Rubertina che insegna a sonar de viola d'archo tastada da Silvestro Ganasi (sic) del Fontego. In Venetia, ad instantia de l’autore, 15112, pet. In- 4° oblong.), a représenté dans le frontispice de son livre un concert où les violes ont des chevalets.
Deux faits nouveaux de grande importance se révèlent dans les figures publiées par Agricola, Nachtgall et Ganassi del Fontego, à savoir, les échancrures qui ont remplacé les dépressions d'une courbe peu prononcée sur les côtés des instruments, et les cases que nous voyons sur les manches des violes, comme on les voit encore aux guitares. Les figures représentent ces échancrures d'une manière inexacte, car elles ont une étendue trop grande, et les parties supérieure et inférieure des instruments se trouvent ainsi réduites à des proportions trop petites. Quelques violes et basses de viole du seizième siècle, qui existent encore dans des cabinets de curiosités, démontrent que les échancrures étaient moins étendues, quoiqu'elles fuissent proportionnellement plus grandes que dans les violons, altos et violoncelles.
L'inhabileté des exécutants fit imaginer de placer des cases sur le manche des instruments, afin de leur indiquer les endroits où ils devaient poser les doigts pour former les intonations ; en sorte qu'au lieu d'être des instruments à sons variables pour la justesse absolue, les violes devinrent des instruments à sons fixes et tempérés. Cet usage a été conservé jusque dans la première moitié du dix-huitième siècle, bien que le violon se fût débarrassé de cette entrave depuis près de cent cinquante ans.
Il y eut évidemment une grande variété dans la construction des violes au moment où la musique véritable commença à se former et lorsque l'harmonie s'épura. Cette transformation s'opéra vers la fin du quatorzième siècle, par les efforts heureux de trois musiciens supérieurs à leur temps, qui furent Dufay, Binchois et Dunstaple. Alors l'art tout entier fût considéré dans l'harmonie que formaient les voix d'espèces différentes par leur réunion. Ce qui avait lieu pour les voix, on voulut le faire pour les instruments ; et comme il y a des voix aiguës, appelées soprano, moins élevées, qu'on désigne sous le nom de contralto, moyennes, qui sont les ténors, et graves, appelées basses, on imagina de faire dans chaque genre d'instruments des familles complètes qui représentaient ces quatre espèces de voix. Les violes, les hautbois, les flûtes, les cornets, etc., eurent leur soprano, leur alto, leur ténor et leur basse, quelquefois même leur contre-basse. Cette division, qui s'établit au quinzième siècle, se maintint pendant les seizième et dix-septième, ou plutôt n'a pas cessé jusqu'à ce jour, au moins pour les instruments à archet. Les instruments les plus vulgaires eurent leur quatuor complet ; ainsi l'on voit, dans le livre d'Agricola, le dessus, l'alto, le ténor et la basse du rebec, tous montés de trois cordes, avec un chevalet triangulaire, dont le sommet supportait la corde du milieu, afin que l'archet ne touchât pas les trois cordes à la fois. On aperçoit de singulières variations dans la forme, les dimensions des violes et la manière de les monter, dès la première moitié du seizième siècle. Le livre d'Agricola, imprimé en 1529, nous présente un quatuor complet de petites violes à tête renversée comme celle des luths, et montées de trois cordes seulement. Agricola les désigne sous le nom de kleine Geigen mit Biïnden und mit dreien Seyten (petites violes avec éclisses et avec trois cordes). Comme tous les instruments de même espèce, leur manche est divisé en six cases (Musica instumentalis, p. li, Iii.) Michel Praetorius dit en effet dans son Organographie, imprimée en 1619 (Syntagma Musicum, t. 11, p. 45.), qu'on fit usage de violes à trois cordes dans les anciens temps, et qu'il y en eut d'autres à quatre et à cinq cordes. Agricola donne les figures du quatuor de violes à quatre cordes (Loc. cit., p. xlvi, verso.), dont les détails de construction sont semblables à ceux des violes à trois cordes. Voici l'accord des quatre instruments qui composent le quatuor :
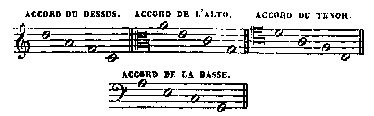
Enfin, les grandes violes à cinq cordes dont parle Agricola formaient un quatuor comme les autres, avec cette différence, toutefois, que la basse était montée de six cordes. Elles s'accordaient de cette manière :
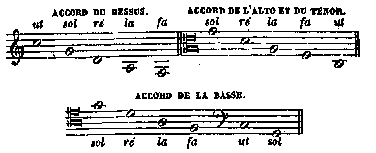
Mais dans le temps même où les instruments à archet de l'espèce des violes étaient classés, montés et accordés, en Allemagne, comme on vient de le voir les violes de l'Italie présentaient des différences remarquables, ainsi que nous le voyons dans le livre précieux de Ganassi del Fontego sur l'art de jouer de ces instruments. Les violes italiennes étaient montées de six cordes ; elles avaient sur la touche sept cases, au moyen desquelles chaque viole était divisée dans son manche en une échelle chromatique de deux octaves et demie. Leur accord était celui-ci :
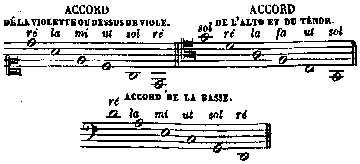
Quelquefois l'alto différait du ténor en ce qu'il était accordé une quinte au-dessus de la basse. Remarquons que cette manière d'accorder les instruments à archet par deux quartes en descendant, suivies d'une tierce, et celle-ci de deux quartes, est exactement celle du luth et de ses variétés. Il est évident que dès lors, c'est à dire dès la première moitié du seizième siècle, l'art se formulait dans un système régulier. C'est le même accord que nous retrouvons, en 1601, dans le traité de musique de Cerreto (Della Prattica musica vocale et strumentale, lib. iv, p. 331.) ; c'est encore le même que nous présente Mersenne dans son Harmonie universelle, en 1636 (Traité des Instruments à chordes liv. iv, p. 194.).
Cependant, si nous retournons en Allemagne dans la première moitié du dix-septième siècle, nous y trouvons des différences dans les violes qui méritent de fixer un moment notre attention. Michel Praetorius, grand musicien, compositeur d'une rare habileté et savant dans l'histoire autant que dans la théorie de son art, est auteur d'un grand traité de musique dont le deuxième volume est entièrement consacré aux instruments de son temps et des époques antérieures (Syntagmatis musici tomus secundus. De Organographia, p. 25.) Or, nous y voyons que le quatuor de viola di gamba (viole de jambe), comme disent les Allemands depuis cette époque, ou plutôt le quintette (car il y a des contre-basses de viole), nous y voyons, dis-je, que ces instruments étaient dans des proportions plus grandes, et que leur accord était plus bas. Nous y voyons aussi que la violette, on soprano, était montée de trois, de quatre, de cinq ou de six cordes, suivant les circonstances ; que l'alto n'avait que trois ou quatre cordes ; le ténor, cinq ou six ; la basse, trois, quatre ou six, et la contre-basse, cinq ou six. Enfin, nous voyons que, lorsque ces instruments avaient six cordes) à l'exception de l'alto, leur accord était celui-ci :
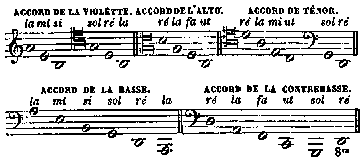
Ainsi qu'on le voit, ces instruments sont tous montés une quarte plus bas que les violes italiennes. A ce diapason ils ne pouvaient produire qu'une musique sourde et triste. Ils se jouaient tous sur le genou, à l'exception de la basse, qui se tenait entre les jambes, et de la contre-basse, qu'on jouait debout.
Il y avait une autre viole dont les éclisses étaient moins élevées que celles de la basse de viole, et qu'on appelait viole bâtarde (viola bastarda), parce qu'elle était accordée par quintes et par quartes.
Nous sommes arrivés vers la fin du seizième siècle, et jusqu'à cette époque rien ne nous fait apercevoir le violon dans sa forme, bien que le nom violino soit mentionné déjà dans un livre de Jean-Marie Lanfranco, imprimé à Brescia en 1533 (Scintille, ossia regole di musica, che mostrano a leggere il canto firmo e figurato, gli accidenti delle note mensurate, le proportioni e tuohi, il contrapunto e la divisions d'il monocorde ; con la accordatura di varii instruments, etc, cap. ultimo.) Parle-t-il du violon tel que nous le connaissons aujourd'hui, ou bien 'de la petite viole, qui fut appelée un peu plus tard violetta ? C'est ce qu'il est difficile de décider. La première indication précise, bien que donnée d'une manière indirecte et sans aucun développement, se trouve dans la première partie de la Pratica di Musica, de Louis Zacconi, imprimée à Venise en 1596. Il y donne l'étendue des divers instruments de son temps, et dans le nombre se trouve celle du violon, représentée de cette manière
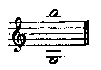
C'est là, en effet, l'étendue réelle du Violon, depuis la quatrième corde à vide de l'instrument jusqu'à l'emploi du quatrième doigt sur la chanterelle ; car le démanché était alors complètement inconnu, et même le fut encore longtemps après. Or cette étendue ne répond à celle d'aucune viole connue. Cependant, quoique le violon existât évidemment dès lors, il était sans doute d'un usage peu répandu en Italie, car on n'en voit pas paraître le nom dans l'énumération et dans l'analyse des instruments donnée par Cerreto dans son livre imprime en 1601 (Lib. IV, cap. viii-xi, p. 313-335.). Le premier emploi certain du violon ne se rencontre que dans I'Orfeo, de Monteverdi, qui fut représenté à Mantoue en 1607 ((- L'Orfeo, favola in musica da Claudio.monteverde, maestro di capella della serenissima republica (di venezia), rappresentato in Mantova l'anno 1607. Venise, 1615, 2° édition.) ; mais les paroles mêmes de l'auteur nous portent à croire que cette modification de la viole n'est pas originaire de l'Italie ; car, dans l'énumération de son orchestre, laquelle précède la symphonie d'introduction, il mentionne, à côté de dix violes da brazzo, de trois basses de jambe et de deux contrebasses de viole, deux petits violons à la française (duoi violini piccoli alla francese). Quoi qu'il en soit, nous trouvons bientôt après le violon, avec la forme que nous lui connaissons, dans le Theatrum Instrumentorum, seu Sciagraphia, de Michel Praetorius, publié à Wolfenbuttel en 1620. Les échancrures, les coins de tasseaux, les filets, sont semblables à ceux de notre violon. Les ff sont substitués aux oc ; le manche, dégagé, étroit et arrondi, y a pris la place du manche large et plat des violes ; la touche est débarrassée des cases. Le chevalet seul est encore plein, et découpé seulement dans la partie inférieure qui forme les pieds (Voy. la sciagraphia de Practorius, Pl. XX, fic. 4 et 5.). Déjà le système est complet, car nous y trouvons la quinte ou alto, le violoncelle et la grosse quinte basse, ou contre-basse. L'accord du violon est mi, la, sol ; celui de l'alto, la, ré, sol, ut ; celui du violoncelle, semblable à celui de l'alto, une octave plus bas ; et enfin celui de la quinte basse, qui est montée de cinq cordes, est :
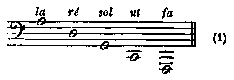
Tel est l'aperçu, restreint aux notions les plus nécessaires, de l'histoire des instruments à archet, antérieurement aux temps d'illustration de la grande école italienne. Nous avons maintenant à suivre la filiation des luthiers de cette école qui ont contribué aux progrès et aux transformations de la facture des instruments, avant les derniers perfectionnements fixés par le grand maître qui est l'objet de cette notice.
1 Syntagm. music., t. 11, p. 26.
LUTHIERS DES ÉCOLES ITALIENNES
DEPUIS
LES PREMIERS TEMPS.
Le quinzième siècle ne nous révèle qu'un seul nom, et ce nom est un objet de doute. Suivant Laborde, il y eut en Bretagne, vers 1450, un luthier nommé Kerlin, dont il avait vu un violon construit en 1449. En 1904, c'est-à-dire environ vingt-cinq ans après l'époque où Laborde écrivait, cet instrument s'est trouvé en la possession de Koliker, luthier à Paris ; c’est alors que nous l'avons vu. Ce n'était pas un violon, mais une viole dont le manche avait été changé, et qui était montée à quatre cordes, comme un violon. L'instrument était plus bombé que ne le sont les violes d'une époque postérieure, et ses voûtes étaient fort élevées. Ses extrémités inférieure et supérieure n'étaient pas exactement arrondies, et les angles étaient tronqués et aplatis. Au lieu de la queue ou cordier ordinaire, on y voyait une attache en ivoire percée de quatre trous pour fixer les cordes ; ce qui semble indiquer que cet instrument appartenait à l'espèce des geige à quatre cordes dont il est parlé dans le livre de Martin Agricola. La qualité des sons était douce et sourde. L'instrument portait intérieurement cette inscription : Joan. Kerlino, an. 1449. Ce nom, commencent par la syllabe Ker, est probablement ce qui a fait croire à Laborde que le luthier était Breton ; car on connaît en Bretagne une immense quantité de familles dont les noms commencent de la même manière ; mais des renseignements venus d'Italie depuis peu, et fournis par un correspondant de M. Vuillaume, qui a fait pendant longtemps le commerce des instruments à archet, et qui en a eu de toutes les origines dans les mains, ces renseignements, nous apprennent qu'il y eut un luthier à Brescia, vers 1450, nommé Jean Kerlino. Tout porte à croire que l'instrument possédé par .Kolilker, au commencement de ce siècle, avait été fait par cet artiste, et que celui-ci fut le fondateur de l'école de Brescia, l'une des plus anciennes de l'Italie et l'une des plus distinguées. Il est à remarquer que Kerlino, de même que tous les luthiers de la première époque dont les noms et les ouvrages sont connus, n'ont fabriqué que des rebecs, des violes de toutes dimensions, des lire d'arco et des lirone à onze et douze cordes.
Après Kerlino, le plus ancien luthier italien est Pietro Dardelli, de Mantoue, qui travaillait dès 1500, et dont il reste encore quelques belles violes dans les cabinets des curieux. Puis vient Gaspard Duiffoprugcar, artiste célèbre, né dans le Tyrol italien, et qui s'établit à Bologne vers 1510. De beaux instruments de ce luthier, tels que basses de viole, ténors et violettes, ou par-dessus de viole, construits par Duiffoprugcar pour la chapelle et la chambre de Francois 1er, roi de France, ont été possédés jusqu'à l'époque actuelle par divers amateurs de Paris. Une superbe basse de viole, dont le fond représente le plan, de Paris au quinzième siècle, laquelle provient de la même ; source, est la propriété de M. Vuillaume, après avoir été celle d'un amateur nommé J.-M. Raoul, ancien avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation. Cet amateur, violoncelliste de quelque mérite, de qui l'on a publié quelques compositions et une méthode de violoncelle, avait tenté la résurrection de la basse de Viole à laquelle il donnait le nom d'heptacorde, . Une notice sur le travail de M. Raoul à ce sujet a été publiée dans la Revue musicale de l'auteur du présent écrit (tome 11, pag. 56-61).
Si nous approchons progressivement du milieu du seizième siècle, nous trouvons Venturi Linarolli, qui travaillait à Venise en 1520 ; Peregrino Zanetto, de Brescia, en 1540, et Morglato Morella, de Mantoue, peut-être élève de Dardelli, et dont on connaît des instruments qui portent la date de 1550. Ainsi qu'on vient de le voir, ces vieux maîtres n'ont construit que des violes de toute espèce et de toute dimension. La plupart de ces violes ont été détruites pour faire des altos et pour réparer les anciens instruments maintenant en usage. Les luthiers modernes les ont toujours recherchées pour cette destination.
A la première époque de lutherie italienne, dont il vient d'être parlé, succède celle de la création du violon, ainsi que ses analogues dans les voix plus graves, l'alto, le violoncelle, la basse, de dimension un peu plus grande que celui-ci, et la quinte-basse, ou contrebasse primitive. Le premier en date entre les artistes de cette seconde époque est Gaspard ou Gasparo de Salo, ainsi nommé parce qu'il était né dans la petite ville de Salo, sur le lac de Garda, en Lombardie. Il fut un des meilleurs luthiers de l'Italie au seizième siècle, et travailla à Brescia depuis 1560usqu'en 1610, c'est à dire pendant près de cinquante ans ; car on trouve des instruments sortis de ses mains à ces dates éloignées. Gasparo de Salo était renommé particulièrement pour ses violes, basses de viole et violons, ou contre-basses de viole ; cependant on connaît de lui quelques violons distingués par leur qualité. Il s'en est trouvé un très remarquable, portant la date de 1566, dans une collection d'instruments précieux qui fut vendue à Milan en 1807. Le baron de Bagge en possédait un vers 1788, dont Rodolphe Kreutzer ne parlait qu'avec admiration. M. T. Forster, amateur anglais, chez qui se trouve une nombreuse collection de violons, en a un qui porte intérieurement l'inscription : Gasparo di Salo in Brescia, 1613. Sa qualité de son est claire, mais courte. Si cet instrument est l'ouvrage de celui dont il porte le nom, c'est un produit dégénéré de la -vieillesse de son auteur.
Venu un peu plus tard, et peut-être élève de l'artiste qui vient d'être nommé, Jean-Paul Magini, né à Brescia, travailla dans cette ville depuis 1590 environ jusqu'en 1640. il se distingua particulièrement dans la facture des violons. Le patron de ses instruments est en général grand, et les dimensions sont les mêmes que celles de Gaspard de Salo, et d'un travail analogue. Les voûtes sont prononcées et s'étendent près des bords. Les éclisses ont peu d'élévation ; les tables d'harmonie sont de bonne qualité et assez fortes ; les fonds, dont le bois est pris sur couche, ont généralement peu d'épaisseur. Remarquable par sa finesse, le vernis, d'un jaune brun clair, est d'excellente qualité. Les dimensions en étendue et la combinaison des voûtes avec celle des épaisseurs donnent à la plupart de ces instruments un son grandiose, grave et mélancolique.
Rien de certain avant Gasparo de Salo sur la forme définitive du violon ; mais on voit avec évidence, par ses produits, que dès lors la forme actuelle de cet instrument était fixée. Dans la suite il n'y a plus que des différences de détails entre les instruments de diverses origines, différences sensibles seulement pour des yeux très exercés.
Un contemporain de Jean-Paul Magini, Antoine Mariani, de Pesaro, a fait aussi des violons depuis 1570 jusque vers 1620 ; mais ses instruments, faits à l'aventure et sans principes arrêtés, n'ont pas de valeur et ne sont pas recherchés, même comme objets de curiosité. Il n'en est pas de même de ceux de Magini. Dans les premières années de ce siècle, ils étaient peu connus en France ; c'est le célèbre violoniste de Bériot qui a fixé l'attention des artistes sur leurs qualités, et qui a fait la réputation de ces violons par les succès qu'il a obtenus à Paris et à Londres avec un instrument de ce maître.
Il ne faut pas confondre Jean-Paul Magini avec autre luthier de Brescia, vraisemblablement de la même famille, lequel travaillait dans le dix-septième siècle et se nommait Santo Magini. Bien qu'il ait fabriqué des violons, celui-ci s'est particulièrement distingué par ses contre-basses, qui sont renommées en Italie comme les meilleurs instruments de ce genre.
L'école de Brescia a eu aussi, vers 1580, deux autres artistes de mérite, bien que dans un ordre inférieur à Jean-Paul Magini. Le premier est Javietta Budiani, l'autre Matteo Bente. Les instruments de ce dernier sont recherchés par les amateurs de collections.
Nous arrivons au chef d'une famille illustre dans la facture des instruments de musique, qui fut aussi le fondateur de la grande école de Crémone. André Amati descendait d'une ancienne famille décurionale de cette ville, laquelle est mentionnée dans les annales crémonaises dès 1097. On ne sait pas la date de sa naissance, parce que les registres des églises de Crémone ne remontent pas jusqu'au commencement du seizième siècle, époque qui parait avoir été celle de sa naissance ; ni mais, à défaut de l'acte de baptême, on a sur cet artiste un renseignement positif fourni par un violon à trois cordes, ou rebec, lequel existait dans la collection précieuse d'instruments formée par le comte Cozio de Salabue, de Casal-Monferrato, qui se trouvait à Milan dans la maison du chevalier Charles Carli. Cet instrument portait le nom d'André Amati et la date de 1546. Le baron de Bagge possédait aussi, vers 1788, une viole moyenne, appelée autrefois en Italie viola bastarda, qui portait la date de 1551. Il est donc certain qu'André Amati était né dans les vingt premières années du seizième siècle.
Quel fut le maître d'André? où acquît-il l'habileté de main qu'on remarque dans ses ouvrages? On l'ignore. L'auteur d'une lettre insérée dans la Correspondance des professeurs et des amateurs de musique, que publiait Cocatrix en 1803, assure que ce fut à Brescia qu'André Amati travailla comme apprenti avant d'établir lui-même un atelier à Crémone. Le fait n'est pas impossible, car ces deux villes sont des points assez rapprochés dans la Lombardie ; mais les allégations de cette espèce n'ont pas de valeur lorsqu'elles ne sont pas appuyées par des documents d'une authenticité incontestable. Les instruments d'André Amati ont des formes particulières qui les distinguent sensiblement de celles de l'ancienne école de Brescia. Il a dû faire des études spéciales avant d'adopter les dimensions qui répondaient aux nécessités de son époque. Lorsqu'il travaillait, personne ne recherchait la puissance et l'éclat du son qu'on demande aujourd'hui ; loin de là, l'instrument qui aurait eu cette grande sonorité aurait blessé l'oreille d'un auditoire accoutumé à la musique douce dont nous voyons encore les monuments. Les épinettes, les luths, théorbes, mandores et guitares, tous ces instruments dont se formaient les concerts de chambre et de salon (il n'y en avait point d'autres alors), tout cela, disons-nous, avait peu de son. Ce qu'on demandait à un luthier de cette époque, c'est que ses instruments fussent doux et moelleux. Eh bien! il faut rendre cette justice au chef de la famille des Amati : ses violons, ses violes, ses basses ne laissaient rien à désirer sous ce rapport.
André Amati a fait beaucoup d'instruments ; mais le temps les a usés, et les accidents en ont anéanti un grand nombre. Avant la première révolution française (1789), il existait dans le mobilier de la chapelle royale une collection de violons et de violes qui avaient été faits par André Amati à la demande de Charles IX, amateur passionné de musique. Après les journées des 5 et 6 octobre 1790 tous ces instruments disparurent de Versailles. Cartier (voyez ce nom dans la Biogi-aphie universelle des Musiciens) retrouva deux de ces violons plusieurs années après ces événements. Leur sonorité avait peu d'éclat, mais le timbre était plein de charme, et le travail était remarquable pour le fini.
Les violons d'André Amati sont de petit et de moyen patron ; leurs voûtes sont très prononcées vers le centre. Le bois du fond est pris sur couche ; les tables, de bonne qualité, ont des épaisseurs suffisantes ; le vernis, brun clair, a de la solidité. Ainsi que nous venons de le dire, leur intensité de son est relative à l'époque où ils ont été fabriqués.
L'époque de la mort d'André Amati n'est pas connue ; mais il est vraisemblable qu'elle eut lieu vers 1580, car les instruments signés du nom d'Amati, après cette époque, appartiennent à ses fils, Jérome et Antoine. Celui-ci, né à Crémone vers 1550, succéda à son père, et fut quelque temps associé de Jérôme, dont il se sépara ensuite.
Antoine avait adopté les patrons d'André ; mais il fabriqua un nombre plus considérable de petits violons que de grands. Ceux-ci, lorsqu'ils sont le produit de l'association des deux frères, sont estimés et fort recherchés s'ils sont dans un bon état de conservation. Le violoniste Libon en possédait un admirable par le charme du timbre, avec lequel il exécutait les quatuors de Haydn, vers 1809, chez MM. de Sermentôt, de Noailles et de Villeblanche, amateurs passionnés, chez qui l'on entendait les artistes les plus distingués de cette époque. Le violon de Libon, fait par Antoine et Jérôme Amati, portait la. date de 1591. Les petits violons faits par Antoine Amati ont une qualité de son douce et moelleuse ; malheureusement ce son si pur a peu d'intensité. La chanterelle et la seconde sont les meilleures parties de ces instruments ; la troisième est un peu sourde, et la quatrième est trop faible. Dans les bons instruments des deux frères le travail brille par le fini. Le bois, bien choisi, est pris sur couche pour le fond et pour les éclisses ; le sapin des tables est d'une maille fine et douce ; les voûtes sont élevées au centre, et les gorges sont très évidées. La combinaison des épaisseurs avec les autres conditions que réunissent ces instruments leur donne le son fin, délicat et suave qui est leur qualité distinctive. On croit qu'Antoine Amati mourut en 1635 ; il est certain, au moins, que son nom ne paraît plus dans les instruments postérieurement à cette date.
Après avoir travaillé longtemps avec son frère, Jérôme Amati se maria. Ce changement de position amena la séparation des deux frères. Alors Jérôme ne s'en tint pas à la reproduction exacte des modèles d'André ; car on connaît de lui quelques violons d'un patron plus grand que ceux d'Antoine et du vieil Amati. Jérôme, travaillant seul, a quelquefois approché de son frère pour le fini du travail ; mais en somme il lui est inférieur. Il mourut en 1638.
Au nombre des élèves d'Antoine et de Jérôme Amati on remarque Gioacchino ou Giofredo Cappa, qui naquit à Crémone en 1590. En 1640 il alla s'établir dans le Piémont, et y fonda l'école de lutherie de Saluzzio ou Saluces, où demeurait alors le prince souverain. Il y fabriqua un grand nombre d'instruments et y forma de bons élèves, parmi lesquels Acevo et Sapino, dont les produits, sans égaler ceux des Amati, furent estimés autrefois. Les violoncelles de Cappa sont ses meilleurs produits.
Nicolas Amati, fils de Jérôme, le plus célèbre, à juste titre, des artistes de ce nom naquit le 3 septembre 1 596, et mourut le 12 août 1684, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, suivant les registres de la cathédrale de Crémone. Il changea peu de choses aux formes et aux proportions adoptées dans sa famille ; mais il y mit plus de fini dans les détails, plus de perfection dans le dessin des courbes, et eut un vernis plus souple, plus moelleux et d'un plus bel aspect. Les combinaisons des voûtes et des épaisseurs de ses instruments sont mieux calculées que dans ceux d'André, d'Antoine et de Jérôme. De là vient qu'en conservant la suavité de son qui les distingue ils ont plus de puissance et d'éclat. Quelques violons auxquels ce luthier célèbre semble avoir travaillé avec prédilection sont de -véritables chefs-d’œuvre de lutherie.
L'un deux, qui portait la date de 1668, se trouvait à Milan, dans la collection du comte Cozio de Salabue. par la perfection de ses détails, la pureté et le moelleux de ses sons, cet instrument était considéré comme une merveille en son genre. . le comte de Castel-Barco, de la même ville, en possède aussi qui sont admirables, et l'on cite celui du célèbre violoniste Allard comme un des meilleurs instruments sortis des mains de Nicolas Amati.
Nicolas eut de sa femme, Lucrèce Pagliari, deux fils, dont l'aîné, Jérôme, naquit le 26 février 1649, et l'autre, Jean-Baptiste, né le 13 août 1657, fut prêtre, et mourut vers 1706. Jérôme travailla dans l'atelier de son père et lui succéda. il élargit un peu le patron des violons ; mais il fut beaucoup moins soigneux dans son travail que les autres membres de, sa famille, et très inférieur à son père. Du reste, il a peu produit. On connaît de lui un violon qui porte la date de 1672 c'est un de ses derniers ouvrages. Jérôme fut le dernier artiste du nom d’Amati.
Les élèves formés par Nicolas Amati, sont : Jérôme, son fils, André Guarnérius, Paolo Grancino, qui se fixa à Mlilan, et travailla depuis 1665 jusqu'en 1690, et l'illustre ANTOINE STRADIVARI ou STRADIVARIUS, de Crémone, qui est l'objet principal de notre travail.
On considère généralement comme appartenant à l'école des Amati les luthiers dont nous allons donner la liste chronologique, soit qu'ils aient travaillé chez Jérôme ? fils de Nicolas, soit qu'ils aient été formés par des élèves de cette école, et qu'ils en aient suivi les traditions avec plus ou moins d'exactitude.
ÉCOLE DES AMATI.
Joseph Guarnérius, fils d'André, à Crémone. de 1680 à 1710
Florinus Florentus, à Bologne.. de 1685 à 1715
Francois Rugger (ou Ruggieri), surnommé il Per. A Crémone de 1670 à 1720
Pierre Guarnérius, frère de Joseph et second fils d'André de 1690 à 1720
Jean Grancino, fils de Paolo, à Milan de 1696 à 1720
Jean-Baptiste Grancino, frère de Jean, à Milan. . . . de 1690 à 1700
Alexandre Mezzadie, à Ferrare de 1690 à 1720
Dominicelli, à Ferrare. . de 1695 à 1715
Vincent Rugger, à Crémone de 1700 à 1730
Jean-Baptiste Rugger, à Brescia de 1700 à 1725
Pi'erre-Jacques Rugger, à Brescia de 1700 à 1720
Gaetano Pasta, à Brescia de 1710 à . …
Domenico Pasta, à Brescia de 1710 à .…
Francois Grancino, fils de Jean, petit-fils de Paolo, à Milan de 1710 à 1746
Pierre Guarnérius, fils de Joseph, petit-fils d'André, à Crémone de 1725 à 1740
Santo Serafino, à Venise de 1730 à 1745
Les travaux de Gaspard de Salo, de Jean-Paul Magini et des Amati ont déterminé la forme actuelle du violon, née dans le seizième siècle, et portée tout à coup à une perfection qui n'est pas une des choses les moins étonnantes de ce siècle fécond en prodiges. Que l'on, compare cet instrument à une de ces violes dont l'usage s'est conservé en France jusqu'au temps de Rameau (1750), et qui sont connues vulgairement sous le nom de quintons ; on aura peine à comprendre que de cette chose si imparfaite soit sorti du premier jet un instrument dont on a vainement essayé de modifier la forme dans ces derniers temps, et auquel on n'a pu vouloir ôter ou ajouter quelque chose sans le détériorer.
Rien de plus heureux, en effet, que les combinaisons acoustiques du violon : il suffit, pour s'en convaincre, du simple exposé de sa conformation. Sa caisse, dont la longueur est de 35 à 36 centimètres, a 21 centimètres dans sa plus grande largeur, et 11 centimètres dans la plus petite. Sa plus grande épaisseur ne présente qu'un développement de 6 centimètres. Ses parois sont si minces que le poids de la caisse de l'instrument n'est que d'environ 240 grammes ; néanmoins, cette machine, si frêle en apparence, offre une résistance prodigieusement énergique aux causes de destruction qui agissent incessamment sur elle ; car le violon supporte pendant des siècles une tension de 40 à 42 kilogrammes, et une pression de 12 kilogrammes sur sa partie la plus faible. Sa figure symétrique, ses contours gracieux et bien proportionnés, ses échancrures correspondantes dans le milieu de sa longueur ; les surfaces voûtées de ses tables, que consolident l'âme et la barre ; les quatre colonnes triangulaires cachées dans les coins des échancrures, cet les deux tasseaux placés à chaque extrémité, se coordonnent avec tant d'harmonie que la résistance et l'élasticité sont dans un équilibre parfait.
Les échancrures des côtés de l'instrument n'ont pas seulement pour objet de donner à l'archet le moyen d'agir librement sur les quatre cordes, car elles exercent une très heureuse influence sur le brillant et l’énergie du son, en ce que les extrémités de l'instrument produisent des vibrations énergiques qui vont se répercuter à l'endroit même où se produit l'impulsion. C'est ce que n'a pas compris Chanot, lorsqu'il a voulu faire disparaître les échancrures avec leurs angles, croyant faire la plus utile innovation . pour l'accroissement de sonorité du violon, tandis qu'il reproduisait simplement la forme des violes du moyen âge.
Tout a été prévu dans la conformation du violon, non-seulement pour la production de ses sons, mais pour assurer sa solidité, sa conservation, et pour remédier aux accidents imprévus. Par exemple, il était nécessaire qu'on put l’ouvrir pour faire les réparations devenues indispensables. Pour atteindre ce but, on a eu l'ingénieuse idée de donner aux deux tables une étendue suffisante, afin que leurs bords dépassassent les éclisses d'environ 2 millimètres ; ce qui, d'une part, permet de donner un point d'appui à l'outil qui sert à décoller les tables, et, de l'autre, ne laisse pas de traces de l'opération du recollage. En outre, ces bords ont été relevés et ornés d'un large filet de trois couleurs qui dessine l'instrument ; en réalité ils font l'office d'un ourlet destiné à préserver la fragilité des tables. Rien de semblable n'existait dans les violes qui ont précédé immédiatement le violon.
Ce serait une grande erreur de croire que la place et la forme des f, qui, dans le violon, l'alto et la basse, remplacent les ouvertures des instruments plus anciens, est arbitraire : la place de ces f, leur forme, les moindre détails de leurs découpures, sont de telles nécessités qu'on n'a pu y rien changer sans nuire à la qualité du son.
Le manche du -violon ne mérite pas moins d'éloges que les autres parties de l'instrument par la simplicité de sa disposition et par le moelleux de ses contours, si heureusement terminés par l'élégance de la volute. Enfin, l'appareil qui sert à tendre les cordes, dont la mise en vibration révèle les qualités de l'instrument, est ce qu'on peut, imaginer de plus simple et de mieux conçu.
L'érable et le sapin sont les éléments constitutifs du violon ; ces bois présentent des variétés infinies, en raison des pays divers qui les produisent et des climats sous lesquels leur végétation s'est développée. L'érable dont se servaient les anciens luthiers italiens venait de la Croatie, de la Dalmatie, et même de la Turquie. On l'envoyait à Venise, préparé pour les rames qui servaient aux galères, et les Turcs, dit-on, constamment en rivalité, et souvent en guerre avec les Vénitiens, avaient soin de choisir le bois le plus ondé, afin qu'il cassât plus vite. C'est dans ces parties de bois destinés aux rameurs que les luthiers italiens choisissaient ce qui leur convenait pour la fabrication des violons.
Le sapin dont les luthiers de Crémone faisaient usage était pris sur le versant méridional des montagnes de la Suisse italienne et du Tyrol. Stradivarius, dont nous parlons, le choisissait en général dans les parties dont les fibres étaient minces, droites, peu écartées, et toujours placées perpendiculairement au plan du violon.
Nous avons dit, dans ce qui précède, quels furent les résultats des travaux des grands luthiers de l'école de Brescia et de la famille des Amati. Dans les instruments de Gasparo de Salo et de Magini, sonorité, grandiose, majestueuse et pénétrante, mais voilée et mélancolique ; dans ceux de Nicolas, le plus habile des Amati, son pur, suave, argentin, mais faible intensité. Le moelleux et le charme réunis à la clarté, au brillant, à la puissance vibratoire, tel était le dernier problème à résoudre. Un homme vint, et par des progrès constants trouva en définitive le secret de toutes ces perfections combinées. Cet homme fut Antoine Stradivarius ; c'est de lui que nous allons parler. Après avoir rapporté tout ce qu'il a été possible de recueillir sur sa personne et sur sa famille, nous le suivrons dans ses travaux, et nous mettrons hors de doute et de discussion, au moins nous l'espérons, les principes qui ont été le fruit de ses études, et qui l'ont guidé dans les meilleures productions de son talent.
ANTOINE STRADIVARIUS.
PERFECTIONNEMENTS DES INSTRUMENTS À ARCHET.
Antoine Stradivari, né à Crémone, descendait d'une très ancienne famille décurionale et sénatoriale de cette ville. On trouve dans le catalogue des anciennes familles qui ont occupé des emplois publics, lequel se conserve dans les archives municipales de Crémone, une succession de membres de cette famille qui ont été revêtus des plus hautes dignités, depuis 1127 jusqu'en 1474. En 1127, Ottolinus Stradivarius est senator- patriae. En 1186 Egidius Stradivarius a le même titre. Dans un volume manuscrit qui existe aux mêmes archives, et qui a pour titre inscriptiones Crernonenses univesae on trouve l'épitaphe de celui-ci (p. ccx, n° 1512) copiée d'après l'inscription sépulcrale qui existait dans l'église Saint-Laurent des PP. olivétains elle est ainsi conçue :
Egidius. Stradivarius. Patriae suae. Crem. senator
Summa. in Omnes. Munific. Liberalitate. Er.
Hic. Corpus. suum. Jacet
Obiit au. Hum. sal. 1199. 4 Id. apr.
Laura. Schitia. uxor. Carriss. P.
Le même recueil fournit aussi la copie ( P. LXIII, n° 378) de l'épitaphe de Guillaume Stradivertus, excellent jurisconsulte, qui mourut en 1439. Cette inscription existait dans l'église supprimée de Saint-André, à Crémone. La voici :
Ilodie. Mihi. Cras. Tibi
Viator
Respice. Finem
Guglielmus. Stradivertus
J. C. Praestantissimus
Sibi. suisque. Aeredibus
Hic. Situs. Est
Obiit. Anno. MCCCCXXXIX.
On voit, par les registres cités ci-dessus, que la famille Stradivari était appelée tantôt Stradivarius, tantôt Stradivera, et même Stradiverta.
Quelle qu'ait été la persévérance de M. Vuillaume dans ses recherches pour découvrir la date précise de la naissance de Stradivarius, et en dépit de la complaisance dévouée de M. Jules Fusetti, vicaire de la cathédrale de Crémone, qui n'a rien épargné pour atteindre ce but, par des circonstances qu'il est impossible d'expliquer, cette date n'a pu être trouvée. Ce qui est présumable, c'est que, lors de la suppression de plusieurs églises de Crémone, leurs archives auront été soustraites, cachées, et peut-être anéanties. Heureusement, un monument est resté, qui lève tous les doutes sur l'année où le luthier célèbre a vu le jour. Dans les notes de Carlo Carli, banquier à Milan, s'est trouvé un inventaire des instruments qui appartenaient au comte Cozio de Salabue, dont il était dépositaire. Or, on y voit figurer un violon de Stradivarius qui porte intérieurement une étiquette écrite de la main de l'auteur lui-même, et dans laquelle on lit son nom, son âge (quatre-vingt-douze ans), et la date 1736. Stradivarius était donc né en 1644.
Élève de Nicolas Amati, il fabriqua dès 1667, c'est à dire à l'âge de vingt-trois ans, quelques violons qui n'étaient que la reproduction exacte des formes de son maître, et dans lesquels il plaçait l'étiquette de Nicolas. Ce ne fut qu'en 1670 qu'il commença à signer ses instruments de son propre nom. Dans les vingt années qui s'écoulèrent jusqu'en 1690 il produisit peu. On serait tenté de croire que l'artiste était alors plus occupé d'essais et de méditations sur son art que de travaux au point de vue du commerces. Par la disposition du bois pris sur couche, par le patron, par les voûtes et par le vernis, les instruments faits alors par Stradivarius sont peu différents de ceux de Nicolas Amati.
1690 est une époque de transition plus marquée dans le travail d'Antoine Stradivarius. C'est alors qu'il commence à donner plus d'ampleur à son modèle, à perfectionner les voûtes, et qu'il détermine les épaisseurs d'une manière plus rigoureuse. Son vernis est plus coloré ; en un mot, ses produits ont pris un autre aspect ; cependant on y retrouve encore des traditions de l'école de Nicolas Amati. Les luthiers de l'époque actuelle les désignent habituellement sous le nom de Stradivarius amatisés.
En 1700, l'artiste est parvenu à sa cinquante-sixième année ; son talent est alors dans toute sa force, et depuis cette époque jusqu'en 1725 les instruments qui sortent de ses mains sont autant d'œuvres parfaites. Il ne tâtonne plus ; certain de ce qu'il fait, il porte dans les moindres détails le fini le plus précieux. Son modèle a toute l'ampleur désirable ; il en dessine les contours avec un goût, une pureté qui, depuis un siècle et demi, excitent l'admiration des connaisseurs. Le bois, choisi avec le discernement le plus fin, réunit à la richesse des nuances toutes les conditions de sonorité. Pour le fond, comme pour les éclisses, il en change alors les dispositions et le place sur maille, et non plus sur couche. Les voûtes de ses instruments, sans être trop élevées, s'abaissent en courbes adoucies et régulières qui leur laissent toute la flexibilité nécessaire. es ouïes, coupées de main de maître, deviennent des modèles de dispositions pour tous ses successeurs. La volute, qui a pris un caractère plus sévère, est sculptée avec une grande perfection. Les beaux tons chauds du vernis de Stradivarius datent de cette époque : la pâte en est fine et d'une grande souplesse.
A l'intérieur de l'instrument le travail de l'artiste n'offre pas moins de perfection : tout y est fait avec le plus grand soin. Les épaisseurs sont fixées d'une manière rationnelle et se font remarquer par une précision qui n'a pu être atteinte que par de longues études. Le fond, la table, et toutes les parties qui composent l'instrument, sont dans un rapport parfait d'harmonie. Ce furent aussi sans doute des essais réitérés et des observations persévérantes qui conduisirent Stradivarius à faire, dans toute cette période de sa carrière productive, les tasseaux et les éclisses de ses violons en bois de saule, dont la légèreté spécifique surpasse celle de tous les autres bois. Au résumé, tout a été prévu, calculé, déterminé d'une manière certaine dans ces instruments admirables. La barre seule est trop faible, par suite de l'élévation progressive du diapason depuis le commencement du dix-huitième siècle, laquelle a eu pour résultat inévitable une augmentation considérable de tension et une pression beaucoup plus grande exercée sur la table. e là est venue la nécessité de rebarrer tous les anciens violons et violoncelles.
A la même époque où Stradivarius était parvenu à la perfection dont il vient d'être parlé, et lorsqu'il travaillait avec la certitude des résultats, il s'est quelquefois écarté de son type définitif pour satisfaire des fantaisies d'artistes ou d'amateurs. C'est ainsi qu'il a fait des violons d'un patron plus allongé : leur aspect a moins de grâce, mais les mêmes soins ont présidé à leur confection ; tout y est proportionné à cette modification de la forme, pour maintenir l'équilibre dans les vibrations. Dans ces instruments, comme dans les autres sortis des mains de l'artiste à cette période de sa vie, la sonorité a cette puissance noble, ce brillant, cette distinction qui ont assuré partout la grande renommée de Stradivarius.
Les instruments produits par Stradivarius de 1725 à 1730 ont encore de la qualité ; toutefois le travail n'a plus la même perfection. Les voûtes sont un peu plus arrondies, d'où résulte un peu moins de clarté dans le son ; la délicatesse et le fini du travail s'altèrent progressivement ; le vernis est plus brun. La fabrication paraît aussi se ralentir ; car on rencontre moins d'instruments de cette époque que de la précédente, proportion gardée.
En 1730, et même un peu avant, le cachet du maître disparaît presque complètement. Un œil exercé reconnaît que les instruments ont été faits par des mains moins habiles. Lui-même en désigne plusieurs comme ayant été faits simplement sous sa direction : sub disciplina, Siradivarii. Dans d'autres, on reconnaît la main de Charles Bergonzi et des fils de Stradivarius, Omobono et Francesco. Après la mort de cet homme célèbre, beaucoup d'instruments non terminée existaient dans son atelier : ils furent achevés par ses fils. La plupart portent son nom dans l'étiquette imprimée, de là résultent l'incertitude et la confusion à l'égard des produits des derniers temps.
Stradivarius n'a fait qu'un petit nombre d'altos : tous sont de grand format. Leur qualité de son, pénétrante, noble, sympathique, est de la plus grande beauté.
Les violoncelles sortis de ses mains sont en plus grande quantité : on y remarque la même progression ascendante pour la perfection du travail et le fini précieux que dans les violons. Ces instruments sont de deux dimensions : l'une grande, à laquelle on donnait autrefois le nom de basse ; l'autre plus petite, qui est le violoncelle proprement dit. A la première de ces catégories appartient la basse de M. Servais, professeur au Conservatoire royal de Bruxelles, et virtuose dont la renommée est européenne. La sonorité de ce bel instrument a une puissance extraordinaire réunie au moelleux argentin. Le violoncelle de l'excellent artiste M. Franchomme est de l'autre patron ; il appartint autrefois à Duport : c'est un instrument du plus grand prix. On préfère aujourd'hui ce patron, dont les dimensions sont commodes pour l'exécution des difficultés. Il faut la main de Servais pour une basse aussi grande que la sienne.
Les violoncelles de Stradivarius ont une immense supériorité sur tous les instruments du même genre : leur voix puissante a une ampleur, une distinction de timbre et un brillant que rien n'égale. Ces précieuses qualités résultent, d'une part, du choix des bois, de l'autre, de la force des épaisseurs, qui sont traitées d'une manière large, et enfin des rapports exacts de toutes les parties de l'instrument, lesquelles sont équilibrées pour que les vibrations soient libres, énergiques et prolongées. Ce qui assure la supériorité de ces instruments est, comme dans les violons, l'application constante des lois de l'acoustique.
A l'époque où Stradivarius travaillait, les violes de toute espèce étaient encore en usage dans les orchestres ; lui-même en fabriqua beaucoup de diverses formes et dimensions, à six et à sept cordes, ainsi que des quintons à fond plat, avec des éclisses élevées et des tables voûtées ; enfin, des guitares, des luths et des mandores. un de ces derniers instruments, construit par ce grand artiste, se trouve à Paris en ce moment : la finesse du travail et la beauté du vernis sont très remarquables ; les sculptures de la tête sont d'une rare délicatesse, et dans son ensemble comme dans ses détails ce joli instrument réunit tous les genres de perfections.
Deux choses sont également dignes d'attention dans les travaux d'Antoine Stradivarius, à savoir, l'excellence de ses instruments et leur nombre presque infini. Il est vrai que la multiplicité de ses produits s'explique par le grand âge auquel il parvint, et par sa persévérance au travail, qui se soutint jusqu'à ses derniers jours. Stradivarius fut du petit nombre de ces hommes qui, se posant la perfection pour but, autant qu'il est donné à l'humanité de l'atteindre, ne s'écartent pas de la route qui peut les y conduire ; que rien ne distrait, que rien ne détourne de leur objet ; que les déceptions ne découragent pas, et qui, pleins de foi dans la valeur de cet objet, comme dans leurs facultés pour le réaliser, recommencent incessamment ce qu'ils ont bien fait pour arriver au mieux possible. Pour Stradivarius, la lutherie fut le monde tout entier : il y concentra toute sa personnalité. C'est comme cela seulement qu'on s'élève, quand l'aptitude répond à la volonté. La longue existence de quatre-vingt-treize ans, qui fut celle de l'artiste objet de cette notice, s'écoula tout entière dans un paisible atelier, en face d'un établi, le compas ou l'outil à la main.
On a vu précédemment qu'Antoine Stradivari termina un violon à l'âge de quatre-vingt-douze ans, en 1736. Déjà il s'était préparé à la mort depuis plusieurs années, car il avait fait disposer son tombeau dès 1729. On en a la preuve dans l'extrait suivant du livre des inscriptions de Crémone (Inscriptiones Cremonenses universae), dont il a été parlé ci-dessus. Cet extrait est fait en ces termes :
Finalmente nello stesso volume a pag. CXXXII, n° 923, leggesi la Epigrafe del sepolcro del celebre fabbricatore di violini Antonio Stradivari, che era già nel Pavimento, interamente rifatto della Chiesa di San Domenico de Padri Domenicani ed è la seguente :
Sepolero. Di
Antonio. Stradivari
E. suoi, Eredi. An. 1729.
In fede di quanto sopra,
Cremona, le 18 settembre 1855.
Il Prelato Primicerio Antonio Dragoni,
Ex Vicario Generale Capitolare
della Città e diocesi di Cremona
(Finalement, dans le même volume, à la page cxxxii, n° 923, on lit l'épitaphe du tombeau du célèbre fabricant de violons Antoine Stradivari, qui était autrefois dans le pavement, entièrement refait, de l'élise de Saint Dominique des PP. dominicains, laquelle est la suivante :
« Sepolcro. di
Antonio. Stradivari
E. suoi. Eredi. An. 1729.
En foi de ce qui est ci-dessus,
Crémone, le 18 septembre 1855.
Le prélat primicier Antoine Dragoni, ex-vicaire général capitulaire de la ville et du diocèse de Crémone. »).
Suivent trois cachets où l'on voit les armoiries, les noms et qualités du prélat primicier Antoine Dragoni.
La date de 1729, placée sur le tombeau de Stradivari, avait fait croire qu'il était décédé à cette époque ; mais la découverte du violon de 1736, dans lequel Stradivari lui-même avait consigné son âge de quatre-vingt-douze ans, était venue renverser cette tradition. De nouvelles recherches faites avec une persévérance infatigable ont été, enfin, couronnées de succès, et ont fait connaître la date précise de la mort de l'artiste célèbre. Dans un extrait authentique des registres de la cathédrale de Crémone, délivré, et signé par M. Jules Fusetti, vicaire de cette église, on a la preuve qu'Antoine Stradivari fut inhumé le 19 décembre 1737, et conséquemment qu'il était décédé le 17 ou le 18 du même mois, à l'âge de quatre-vingt-treize ans accomplis. Mais, par une singularité inexplicable, ni ses restes, ni ceux de ses enfants, ne furent déposés dans le tombeau qu'il avait fait faire ; car l'extrait de l'acte mortuaire est ainsi conçu :
« Nel libro col titolo : Libro de' Morti nella Chiesa di S. Domenico, esistante nell' archivio di questa parocchia trovasi quanto segue :
« A di19 Dicembre 1737. -Dato sepoltura al fù sig. Antonio Stradivari, sepolto nella sepoltura del sig. Francesco Vitani, nella Capella del Rosario, porocchia di S. Mateo.
Dalla Cattedrale di Cremona,
« Li 19 settembre 1855.
in fede
Signé : Fîisetti Giulio Vico. (avec le sceau de l'église).
(« Dans le livre intitulé : Libro de'morti de l'église Saint Dominique, existant dans les archives de cette paroisse, on trouve ce qui suit : Du 19 décembre 1737. Donné la sépulture à feu M. Antoine Stradivari, inhumé dans le caveau de M. Francois Vitani, dans la chapelle du Rosaire, paroisse de S. Mateo (Matthieu).
De la cathédrale de Crémone, le 19 septembre 1855. Certifié et signé : (Fusetti (Jules), vicaire ».)
Antoine Stradivarius avait été marié, et avait eu trois fils et une fille. Les fils se nommaient Francesco, 0mobono, et le troisième Paolo. Les deux premiers travaillèrent dans l'atelier de leur père jusqu'à sa mort ; mais Paolo se livra au commerce. Si Catherine, fille de Stradivarius, était son premier enfant, on pourrait déterminer à peu près l'époque où il s'était marié, car elle mourut à l'âge d'environ soixante-dix ans, en 1748, suivant un extrait du livre des décès de la cathédrale de Crémone, de 1730 à 1752 (Catarina, figlia del fu Antonio Stradivari, domiciliata sotto la parocchia della catedrale di Cremona, morè nelli anno 1748, nell' età di circa 70, et fu sepolta nella chiesa di S. Domenico. Libro de' morti del 1730 al 1752. (Catherine, fille de feu Antoine Stradivari, domiciliée sous la paroisse de la cathédrale de Crémone, est morte dans l'année 1748, à l'àge d'environ soixante-dix ans, et elle a éte inhumée dans l'église Saint-Dominique). Il résulte de cette date et de l'âge auquel elle était parvenue qu'elle était née vers 1678 ; d'où l'on devrait conclure que le mariage d'Antoine Stradivarius a dû se faire en 1676 ou 1677, c'est à-dire lorsqu'il était âgé de vingt-deux ou vingt-trois ans.
La vie d'Antoine Stradivarius fut calme autant que sa profession était paisible. L'année 1702, seule, dut lui causer d'assez rudes émotions, lorsque, pendant la guerre de la Succession, la ville de Crémone fut prise par le maréchal de Villeroy sur les Impériaux, reprise par le prince Eugène, et enfin prise une troisième fois par les Français ; mais après cette époque l'Italie jouit d'une longue tranquillité dans laquelle s'écoula la vieillesse de l'artiste. On sait peu de chose concernant cette existence dénuée d'événements. Polledro, ancien premier violon de la chapelle royale de Turin, mort il y a peu d'années dans un âge très avancé, rapportait que son maître avait connu Stradivarius, et qu'il aimait à parler de lui. Il était, disait-il, de haute stature et maigre. Habituellement coiffé d'un bonnet de laine blanche en hiver, et de coton en été, il portait sur ses vêtements un tablier de peau blanche lorsqu'il travaillait, et, comme il travaillait toujours, son costume ne variait guère. Il avait acquis plus que de l'aisance par le travail et l'économie ; car les habitants de Crémone avaient pour habitude de dire : Riche comme Stradivari. Le vieux La Houssaie, que j'ai connu dans ma jeunesse, et qui avait visité Crémone peu de temps après la mort de Stradivarius, m'a dit que le prix qu'il avait fixé pour ses violons était quatre louis d'or. Dans ces conditions, et à l'époque où il vivait, il a dû en effet acquérir quelques richesses. Bergonzi, petit-fils de Charles (le meilleur élève de Stradivarius, après Guarnerius), mort à l'âge de quatre-vingts ans, il y a quelques années, indiquait l'endroit où travaillait le luthier célèbre, dans la maison qui porte le n° 1239, sur la place Saint Dominique, en face de la porte Majeure. Depuis lors, cette boutique a été longtemps occupée par un tonnelier ; elle l'est aujourd'hui par un tapissier. Ces détails peuvent avoir quelque intérêt pour les admirateurs passionnés des beaux instruments de Stradivarius.
On a posé souvent cette question : Stradivarius avait-i1, pour se guider dans la fabrication de ses instruments, d'autres principes que ceux d'une longue expérience des faits, et l'excellence de ces mêmes instruments n'est elle pas simplement le résultat de cette expérience, et surtout de l'effet du temps sur les bois dont ils sont construits ? A vrai dire, on a plutôt résolu cette question qu'on ne l'a posée ; car je ne connais guère de luthier qui ne soit persuadé qu'un violon ne peut devenir bon s'il n'a été beaucoup joué, et si le temps n'a pas dépouillé le bois dont il est construit de tout ce qui nuit à la bonne qualité des sons. Or, puisqu'il s'agit des faits, il y en a de péremptoires contre ces préjugés : le premier, c'est qu'il y a en ce moment à Paris un violon de Stradivarius construit en 1716, lequel, après être resté soixante ans dans la collection du comte Cozio de Salabue, fut acheté par Louis Tarisio en 1824, puis est devenu la propriété de M. Vuillaume, et n'a jamais été joué. Le bois dont il est fait est du meilleur choix et remarquable par la richesse des ondes. La perfection du travail, la beauté du vernis, rien ne lui manque. C'est un violon neuf, qui semble sortir ; de la main du maître ; c'est enfin le seul, l'unique instrument de Stradivarius qui soit parvenu jusqu'à nous en cet état de conservation. Or, ce monument intact de l'ancienne lutherie, cet instrument que l'archet n'a pas fait résonner dans l'espace de près d'un siècle et demi qui s'est écoulé depuis l'époque de sa fabrication, cet instrument vient donner un éclatant démenti à cette opinion d'après laquelle le son ne pourrait se produire libre et pur qu'après le long usage d'un violon ou d'une basse ; car ici, dans cet instrument neuf, on trouve toutes les qualités réunies) force, moelleux, rondeur, finesse, vibration facile, son distingué, noble, incisif ; en un mot, ce
violon est un type de beauté extérieure et de perfection sonore.
A l'égard des effets salutaires produits par le temps sur les instruments, suivant l'opinion vulgaire, que les violons de Stradivarius et de Guarnérius lui doivent une partie de leurs plus belles qualités, on oublie que les Bocquay, les Pierret, les Despont, les Véron, les Guersan, les Castagnéry, les Saint-Paul et les Salomon ont au moins l'âge des Stradivarius, et qu'on n'obtiendrait pas aujourd'hui cent francs pour le meilleur d'entre eux ; on oublie aussi que les luthiers du Tyrol, qui vécurent dans le dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième, ont acquis également le bénéfice du temps pour leurs instruments, et qu'ils ont eu l'avantage de disposer de bois égaux en qualité ; cependant, qui oserait mettre en comparaison leurs produits avec ceux des deux grands maîtres qui viennent d'être cités ?
Il y a donc autre chose que le temps pour donner la qualité aux instruments, et même autre chose qu'une construction satisfaisante pour l'œil : il y a des lois d'acoustique ; ce sont elles qu'il s'agit de découvrir.
Les lois de l'acoustique, comme toutes celles de la physique, c'est-à-dire de la nature, sont des lois de rapports. Tout phénomène, en effet, résulte de rapports entre certains éléments et certains autres. Stradivarius a-t-il découvert ces lois? Non, sans doute ; mais, en homme supérieur dans son art, il a fait de la physique expérimentale par ses essais, et ce que ses essais, ses recherches et son expérience l'ont conduit à faire avec certitude, est précisément le résultat des lois de l'acoustique qu'un savant a formulées d'après les produits de l'artiste. Prenons-le à son point de départ : que voyons nous dans les instruments de son maître ? Un son pur, argentin, moelleux ; un travail fini avec soin ; mais l'absence d'intensité de la voix de l'instrument, résultant de voûtes trop élevées et du défaut de certaines proportions. Stradivarius lui-même resta pendant un certain nombre d'années dans les mêmes conditions, et ne s'en affranchit que par degrés. Qui le conduit à se modifier ainsi par de lents progrès ? Évidemment, le désir de donner à ses instruments des qualités qui manquaient à ceux de ses prédécesseurs. Ces qualités, il en pressentait donc la possibilité ! La logique la plus simple veut qu'il en soit ainsi.
En 17 00, ses idées sont fixées ; son modèle est trouvé, et la main, habile à seconder les vues de l'intelligence, donne à la forme toutes les perfections désirables. Ce qui a manqué aux Amati, la puissance du son réunie au brillant, au moelleux, il l'a trouvé : il fait ce qu'il veut, parce qu'il sait ce qu'il faut. Est-ce là du hasard? Non ; nous allons en avoir la preuve.
Un homme doué des plus rares facultés pour l'observation des faits et pour les déductions qu'on en peut tirer, Félix Savart, enlevé trop tôt à la science, était préoccupé depuis près de vingt ans du problème des lois par lesquelles peut se produire le meilleur son possible dans les instruments à archet, et était passé par toutes les phases de la transformation des idées sur ce sujet, lorsqu'il prit la résolution de soumettre à l'analyse les instruments de Stradivarius, espérant y puiser des lumières qu'il n'avait pas trouvées ailleurs. Ainsi qu'il l'a déclaré lui-même dans son cours de physique expérimentale professé au Collège de France pendant l'année scolaire 1838-1839, il dut à la complaisance et au zèle de M. Vuillaume pour la science de pouvoir opérer sur un grand nombre de violons de Stradivarius et de Guarnérius, ainsi que sur des débris d'instruments de ces grands maîtres. C'est à la suite de ces expériences réitérées, et variées de mille manières, que le savant professeur formula la théorie de la construction des instruments à archet dont il a exposé les principes dans son cours, et dont il avait préparé une rédaction définitive que la mort l'a malheureusement empêché de terminer et de publier. C'est à ses recherches que j'emprunte ce que je vais dire ici.
Constatons d'abord que toutes les incertitudes qui obscurcissaient l'esprit de Savart concernant les lois qui régissent la construction des instruments à archet se dissipèrent aussitôt qu'il opéra sur les instruments de la grande époque de Stradivarius, parce qu'il y trouva toujours les mêmes résultats produits par les mêmes causes, par les mêmes formes, par les mêmes proportions. Ingénieux autant qu'on peut l'être dans l'art de pénétrer ces causes par des expériences aussi bien conçues que bien exécutées, il put, à la suite de ces expériences, déterminer les lois qui, à l'insu même de l'artiste célèbre qui est l'objet de cette notice, le dirigeaient dans ses travaux.
En thèse générale, les instruments de Stradivarius doivent leurs précieuses qualités, d'abord au choix excellent du bois ; en second lieu, aux rapports de sonorité qui existent entre les diverses pièces qui composent ces instruments ; troisièmement, à la capacité de la caisse combinée avec les épaisseurs des tables, d'où résulte le son produit par les vibrations de l'air sous l'action de l'archet qui ébranle l'appareil sonore ; enfin, au travail exécuté avec la plus exacte précision, et au vernis, dont les qualités essentielles sont de garantir le bois contre l'influence des variations hygrométriques de la température, et de n'opposer aucun obstacle à l'élasticité de laquelle dépend la liberté des vibrations.
L'analyse des Stradivarius a dû commencer par celle de la sonorité des bois employés par le luthier . l'aspect n'est d'aucune ressource pour s'instruire des faits à cet égard ; l'œil le plus exercé n'y peut rien découvrir ; l'expérimentation bien faite peut seule conduire au but.
Tous les bois rendent un son : personne n'en doute ; mais par quel procédé peut-on les interroger pour déterminer l'intonation ? La sonorité spécifique des bois était déjà connue au temps où Mersenne publiait son Traité de l’harmonie universelle (1636) ; il en parle, et indique la percussion comme moyen de la connaître et de la déterminer. Nul doute que ce moyen n'ait été mis en pratique par Stradivarius : on en aura la preuve dans ce qui va suivre. Disons d'abord que les expériences et les découvertes de Chladni sur les vibrations des plaques sonores de toute nature ont fait connaître un moyen préférable à la percussion pour déterminer les intonations spécifiques des bois, sous des dimensions données ; ce moyen consiste dans le frottement d'un archet sur les bords d'une verge dressée convenablement. Or on a cherché une dimension de verge de laquelle on pût obtenir avec facilité un son assez intense pour être apprécié avec exactitude, et pour que l'intonation pût être déterminée et comparée avec d'autres sons produits également par le frottement de l'archet.
Des fragments d'instruments de Stradivarius ont présenté des dimensions assez grandes pour qu'on pût en faire des verges rectangulaires, taillées dans les directions perpendiculaire et parallèle des fibres du bois, d'une longueur de 20 centimètres, larges de 20 millimètres, et d'une épaisseur de 5 millimètres. Ces verges ont été mises tour à tour en vibration, en tenant celle sur laquelle on opérait entre les doigts, de manière à les toucher seulement de chaque bout au quart de la longueur, et présentant le sens de l'épaisseur à l'action de l'archet, dans le milieu précis de la longueur. Sur la surface supérieure on répandait du sable fin et sec, et, pour laisser cette surface parfaitement libre, on tenait la verge d'un côté avec le pouce et l'index et on la soutenait horizontalement en dessous avec le petit doigt. Dans cette position, l'archet agissant, on voyait le sable se séparer en deux lignes parallèles sur les côtés de la verge ; d'où résultait la preuve que toute la verge était entrée en vibrations régulières.
Ces expériences ont donné les résultats suivants :
1° Une verge d'érable bien ondé, dans les dimensions indiquées, provenant d'un fragment de violon de Stradivarius fait en 1717, a produit le la dièse
![]()
2° Une autre -verge d'érable uni, fragment d'un instrument du même mettre fait en 1708 . a donné la même note.
3" Une verge de sapin prise dans un violon de Stradivarius, fait en 1724, a produit le fa
![]()
4° Une autre verge de sapin tirée d'un instrument du même maître, construit en 1690, a donné la même note.
5° Enfin, une troisième verge de sapin provenant d'un instrument de ce célèbre luthier, lequel portait la date de 1730, a donné encore la même note.
Le diapason ayant subi depuis un quart de siècle de continuelles perturbations ascendantes, on s'est servi pour ces expériences de l'ancien diapason, qui donnait pour l'ut du violon 512 vibrations par seconde.
Des résultats si semblables, produits par des bois employés à des époques si éloignées, ne permettent pas de douter que Stradivarius ne fît usage de moyens analogues à ceux dont Savart s'est servi dans ses expériences, et qu'il y attachait une grande importance ; car son coup d'œil, si exercé qu'il fût, n'aurait pu lui faire juger par avance de l'intonation des bois qu'il employait. Ce qui le prouve, c'est que des expériences du même genre, faites sur des bois dont l'aspect était identique, et avec des verges de mêmes dimensions, ont donné des différences énormes, telles qu'une tierce, une quarte, et même plus, lorsque les -verges n'étaient pas sorties de la même pièce de bois.
Voyons maintenant ce que la théorie a tiré d'instruction positive des faits qui viennent d'être exposés, et comment on en conclut avec certitude que les qualités précieuses des instruments de Stradivarius ont été obtenues en vertu des lois de cette théorie, et non par l'effet du temps et de l'usage, qui ne peuvent faire sortir la perfection d'une chose médiocre.
On sait que la table d'harmonie, qui supporte les cordes et le chevalet, est en sapin, et que le fond de l'instrument, ou le dos, est. en érable. Le sapin est préférable à tout autre bois pour la table d'harmonie, à cause de sa faible densité, et surtout de son élasticité (Nous reproduisons ici une partie de ce que nous avons dit dans notre Rapport sur les instruments de musique de l'Exposition de 1855, concernant la théorie des instruments à archet). Sa résistance à la flexion est plus grande, non-seulement que celle de tout autre bois, mais encore que beaucoup de corps métalliques. Elle est égale à celle du verre, de l'acier même, sur lequel elle a l'avantage d'une très grande légèreté. Le son se propage avec autant de rapidité dans le sapin que dans les autres substances qui viennent d'être nommées. Cette vérité se démontre par l'expérience suivante : si l'on prend trois verges de verre, d'acier et de sapin taillé dans le sens des fibres, ayant toutes les mêmes dimensions, et si on les fait vibrer longitudinalement ou transversalement, de manière à leur faire produire le même mode de division vibratoire, l'intonation du son rendu par les trois verges sera exactement la même ; ce qui n aurait pas lieu avec une verge de tout autre bois que le sapin. Ainsi, la vitesse du son est aussi grande dans le sapin que dans le verre et l'acier, où elle est la plus grande ; et, de plus, le sapin offre l'avantage considérable de présenter une grande surface résistant à la flexion dans une table mince comme celle du violon, et d'avoir la plus grande élasticité possible.
L'érable est préférable à tout autre bois pour le fond ou le dos des instruments à archet : les grands maîtres de la lutherie ancienne de l'Italie n'en ont pas employé d'autre. Dans l'érable, la vitesse de propagation du son est beaucoup moindre que dans le sapin : dans celui-ci, elle est de quinze à seize fois et demie plus rapide que celle de l'air, tandis que dans l'érable elle n'est que dix à douze fois plus grande que celle des ondes aériennes. De là vient que, si l'on fait deux verges, l'une de sapin, l'autre d'érable, dans les mêmes dimensions exactes, le son de la verge de sapin sera sensiblement plus élevé que celui de la verge d'érable. Il suit de là que la table d'harmonie et le fond d'un violon, étant dans les mêmes dimensions, n'ont pas une intonation identique. On verra tout à l'heure l'importance de ces données.
Examinons maintenant dans quel rapport doivent être les deux tables avant leur réunion : on n'a pu le déterminer qu'après des expériences réitérées faites avec soin. On a construit un violon avec deux tables de sapin parfaitement à l'unisson : le son était faible et sourd ; on a substitué au fond de sapin un fond en érable à l'unisson avec la table : l'instrument était absolument mauvais et la qualité de son très faible. La raison de ce phénomène se découvre facilement ; car, l'érable n'étant pas doué au même degré que le sapin de la vitesse de propagation des ondes sonores, il est évident qu'on n'a pu mettre le fond de l'instrument à l'unisson de la table qu'en lui donnant trop d'épaisseur. De ces faits résulte la preuve que les deux tables ne doivent pas être à l'unisson. Non-seulement elles ne doivent pas être à l'unisson, mais on doit s'en éloigner sensiblement, afin d'éviter les battements que produisent toujours deux sons qui s'approchent par l’intonation. Pour déterminer le rapport des sons que doivent rendre les deux tables pour la meilleure résonance possible, il a fallu avoir recours à des expériences directes, faites conjointement par Savart et M. Vuillaume sur plusieurs Stradivarius et Guarnérius d'un grand prix. Les sons des deux tables ont été déterminés de la manière suivante : on a serré les tables dans une pince de bois au point où se croisent deux lignes nodales, l'une transversale, l'autre longitudinale, correspondantes aux deux sens d'élasticité du sapin et de l'érable. La mise en vibration par l'archet a produit des lignes longitudinales et transversales qui prouvaient que les deux sens d'élasticité étaient en jeu, et, le système nodal étant le même sur les deux tables, on a trouvé un ton de différence entre elles. Le fond était exactement un ton plus bas que la table d'harmonie.
Pour des expériences contradictoires, on a construit des tables dans d'autres rapports : près de l'unisson, on avait des battements ; an delà de l'intervalle d'un ton, les deux tables ne vibraient plus conjointement d'une manière normale.
Voilà donc un fait nouveau acquis à la science : la table en érable, ou le fond d'un violon, doit être d'un ton plus bas que la table en sapin pour obtenir la meilleure sonorité possible lorsqu'elles sont réunies. Peut-on croire que ce soit par hasard que ce rapport se produise toujours dans les excellents instruments de Stradivarius et de Guarnerius, et que le premier de ces maîtres, dont l'autre fut l'élève, n'ait pas eu des procédés pour déterminer ce même rapport, dont sa grande expérience et son habileté pratique avaient incontestablement reconnu la nécessité? Le hasard peut être une fois la cause productrice d'un fait ; mais il ne répète jamais régulièrement les mêmes choses.
Venons à un autre fait non moins essentiel. L'intensité des sons rendus par un violon dépend de la masse d'air qu'il renferme et qui doit être dans un certain rapport avec les autres éléments, rapport qu'il s'agit de déterminer. Par des expériences ingénieuses, faites avec un appareil qui permettait d'augmenter ou de diminuer la masse d'air contenue dans un violon, on s'est assuré que, si l'on fait résonner les cordes pendant que la masse d'air est moyenne, on obtient des sons à la fois moelleux et puissants ; si le volume d'air est trop grand, les sons graves sont faibles et sourds, les sons aigus sont criards et maigres ; s'il est trop petit, les sons graves ont de l'aigreur, et les sons de la chanterelle perdent de leur éclat.
Si l'on détermine le son produit par l'air de la caisse lorsque le son rendu par les cordes est le plus beau et le plus intense, on trouve qu'il reste dans de certaines limites qui dépendent de la forme et des autres éléments de l'instrument. En essayant la masse d'air contenue dans plusieurs Stradivarius au moyen d'un porte-vent formé d'un simple tube en laiton légèrement conique et aplati à son extrémité la plus large de manière à ne laisser à la sortie de l'air qu'une simple fente, on a trouvé, en appuyant le bord plat de cet appareil sur l'ouverture d'une des f et soufflant par l'autre extrémité, que toujours l'air produisait un son correspondant à 512 vibrations par seconde, qui était celui de l'ut au temps de Stradivarius, mais qui, en 1838, lorsque Savart faisait ses expériences, était le si bécarre. Par la tension excessive que le diapason a prise depuis environ dix-huit ans, le son produit par 512 vibrations est presque à l'unisson de si bémol. Tous les excellents violons de Stradivarius et de Guarnérius ont donné le même résultat. C'est donc encore un fait acquis à la science : l'air contenu dans un violon doit produire, un son égal à 512 vibrations par seconde lorsqu'il est ébranlé par l'appareil dont nous avons parlé. Si l'intonation de l'air est plus haute, les sons graves de l'instrument sont secs ; si elle est trop basse, les sons de la chanterelle sont d 'une émission difficile, et ceux de la quatrième ressemblent à ceux de l'alto.
On demandera peut-être si Stradivarius a fait toutes ces expériences. Non, sans doute ; mais il est certain que, puisqu'il est toujours arrivé aux mêmes résultats pour la quantité d'air contenue dans la caisse de ses instruments, il avait reconnu, par une étude attentive faite sur ses propres produits, que la capacité, tant par la courbe des voûtes que par la hauteur des éclisses en rapport avec le patron du violon, doit être dans certaines proportions qu'il savait toujours réaliser par la merveilleuse dextérité de sa main. Encore une fois, le hasard ne répète pas toujours les mêmes effets.
Les ouvertures des f dans la table exercent une influence importante sur la masse d'air contenue dans l'instrument. On a remarqué que, lorsqu'on colle une bande de papier sur une des f, le son de la masse baissait sensiblement, et que celui de l'instrument s'altérait d'une manière notable. La conséquence de cette expérience est que, si les ouvertures sont plus petites, le son de l'air sera abaissé, et les défauts signalés ci-dessus se manifesteront. Si, au contraire, les ouvertures sont plus grandes, le son de l'air sera plus élevé. C'est là ce qu'on remarque dans un violon de grand patron de Maggini, dont la masse d'air devrait donner un son plus grave que celui de 512 vibrations par seconde, mais qui, au contraire, produit un son plus élevé, parce que les f sont plus grandes que celles de Stradivarius ; mais cette circonstance est une exception dans les instruments de ce maître. C'est par des observations semblables qu'on acquiert la preuve du soin que mettait ce grand luthier, à établir une harmonie parfaite dans toutes les parties de ses instruments, et à faire qu'elles fussent toujours en équilibre. On sait quelle perfection de régularité il a toujours mise dans la coupe de ses f, toujours si pure et si gracieuse !
Quelquefois ce grand maître est sorti de ses dimensions habituelles pour des essais, ou pour satisfaire an goût des artistes et des amateurs qui lui demandaient une certaine qualité de son spéciale ; mais là précisément se trouve la démonstration la plus évidente de l'excellence des principes qui le guidaient dans la fabrication du nombre si considérable de ses instruments parfaits. On a de Stradivarius quelques violons sensiblement plus grands que son patron ordinaire, et dans lesquels la masse d'air n'est pas en rapport exact avec la sonorité des tables ; et bien! ces instruments sont inférieurs aux autres. C'est dans le parfait équilibre de toutes les parties que réside la cause de l'excellence des violons, altos et basses de Stradivarius, ou, pour parler d'une manière plus exacte, de tous les instruments de cette espèce. Aussi remarque-t-on que deux violons, l'un de Stradivarius, l'autre de Guarnérius, qui ont beaucoup d'analogie dans les dimensions et dans les formes, et qui sont l'un et l'autre dans la même harmonie de proportions, ont une ressemblance remarquable de sonorité, et qu'ils sont l'un et l'autre au rang des meilleurs instruments sortis des mains de ces grands maîtres.
La nécessité de l'harmonie des proportions se fait remarquer en tout. Ayez une table trop mince : la sonorité de l'instrument sera faible ; donnez-lui trop d'épaisseur : l'émission des sons deviendra pénible et roide ; vous perdrez par cet excès d'épaisseur les avantages que le bois pourrait -vous offrir par sa rapide transmission des ondes sonores et par sa sonorité spécifique très aiguë. Donnez à votre table supérieure une forme trop bombée, aux voûtes trop d'élévation l'équilibre de la masse d'air sera rompu, et le son de l'instrument deviendra sourd et nasal.
La hauteur des éclisses est aussi de la plus haute importance, car c'est elle qui détermine la capacité de la caisse dans ses rapports avec le plan des tables, et qui, conséquemment, fixe la quantité d'air introduite dans l'instrument. Et c'est ici que l'action de la masse d'air contenue dans une caisse sonore fait voir son importance à l'égard de la production des sons. En donnant à un violoncelle des dimensions proportionnelles à celles du violon, et dans les rapports indiqués précédemment, les tables devraient avoir 35 pouces, et la largeur devrait être de 20 pouces ; car le la de cet instrument est à la douzième inférieure de la chanterelle du violon, et il est nécessaire que le volume du son soit proportionné à la gravité de l'intonation ; cependant ces grandes dimensions seraient incommodes pour l'exécution. Stradivarius a donné à ses violoncelles des tables dont la longueur est seulement de 26 à 27 pouces, et une largeur de 15 à 16 au plus ; mais il a trouvé dans la hauteur des éclisses une compensation nécessaire pour la masse d'air, leur donnant 4 pouces au lieu de 3, qui auraient été la. proportion exacte si les tables eussent été plus grandes. Adopter les proportions de Stradivarius et de Guarnérius pour la hauteur des éclisses des violons est une nécessité pour mettre en rapport harmonique le son de l'air avec celui des tables.
La barre collée sous la table du violon, à la gauche du chevalet, est aujourd'hui trop faible dans les anciens instruments, particulièrement dans ceux de Stradivarius et de Guarnérius : dans tous il a fallu la remplacer par une barre plus forte. Il ne faut pas croire que ces maîtres se sont trompés dans cette partie de leur travail : ils proportionnaient la barre au poids des cordes sur la table, conformément au diapason de leur temps. Tartini a trouvé, par des expériences faites en 1734, que la charge des quatre cordes sur l'instrument égalait 63 livres. Il faut observer que les cordes de Tartini étaient plus minces que celles dont on monte aujourd'hui les violons, et que son chevalet était moins élevé, en sorte que l'angle formé par les coudes était moins considérable. Il y a vingt ans, la chanterelle n'arrivait à son intonation qu'avec un poids de 22 livres, et les autres cordes un peu moins ; la charge était donc d'environ 80 livres. Le diapason s'était élevé d'un demi-ton depuis 1734 ; on montait les instruments en cordes plus fortes, et l'angle qu'elles faisaient sur le chevalet était plus aigu : de là la nécessité de rebarrer les violons. Depuis lors on est tombé dans un tel excès d'élévation du diapason, par la recherche d'une sonorité brillante, qu'il y a près d'un demi-ton de différence entre le diapason de 1830 et celui de 1856. Si l'on faisait une nouvelle expérience de la charge des quatre cordes sur la table des violons, nul doute qu'on ne la trouvât très augmentée. Ce poids énorme tend incessamment à achever la destruction des anciens instruments, et oblige à donner une grande résistance à la barre placée sous la table. Telle est la cause réelle de la nécessité de substituer à l'ancienne barre trop faible des violons de Stradivarius une barre plus énergique.
La plupart des luthiers ignorent qu'il en est de cet appendice comme des tables de l'instrument. Le bois dont la sonorité, dans des dimensions données, est plus aiguë sous l'action de l'archet, est celui qu'il faut préférer pour sa confection ; car, ainsi qu'il a été dit précédemment, dans ces conditions les vibrations sont plus libres et plus promptes . Il en est de même à l'égard du bois qui sert à la fabrication du chevalet.
S'il était nécessaire de prouver, autrement que par les résultats, la connaissance profonde qu'eurent les luthiers célèbres de Crémone de tous les phénomènes de la résonance dans leurs instruments, il suffirait d'examiner la forme du chevalet et de suivre les expériences de Savart sur cette partie essentielle de l'appareil sonore. Par combien de tâtonnements n'ont-ils pas dû passer pour arriver à connaître la nécessité de toutes les découpures qu'on voit dans le chevalet actuel, et que les artistes eux-mêmes ne considèrent que comme des ornements ? Dans le nombre immense de formes diverses de chevalets que présentent les monuments, j'ai choisi seulement deux variétés de chevalets de violes, dont un appartenant à une viole à sept cordes dont le corps n'a de découpures que sur les deux côtés (fig. no 1),
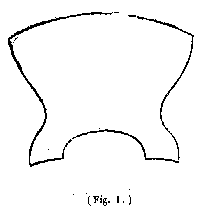
et l'autre provenant d'une viole à cinq cordes entièrement taillé à jour (fig. n, 2) ;
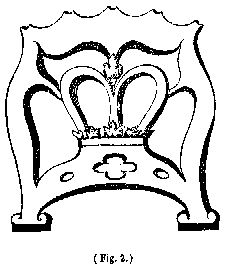
puis deux chevalets de violons, le premier provenant d'un violon petit patron de l'école ancienne d'Antoine Amati (fig. no 3),
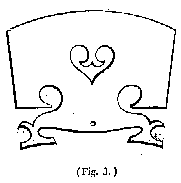
l'autre ayant servi à la monture d'un Nicolas Amati (fig. no 4).
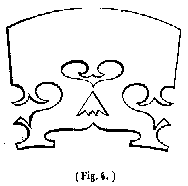
Ces deux derniers appartiennent déjà à la forme définitive du chevalet, mais avec des variétés, soit dans le nombre des découpures, soit dans la direction des traits. C'est Stradivarius qui a fixé définitivement la forme actuelle, représentée par cette figure (fig. no 5).
Des expériences délicates, faites avec les soins les plus minutieux, ont démontré que toutes les modifications qu'on a voulu y introduire ont eu pour résultat d'altérer la sonorité d'un bon instrument.
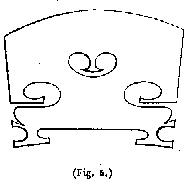
Résumons-nous, et constatons que les belles expériences de Savart ont démontré jusqu'à l'évidence la sûreté, l'excellence des principes qui ont dirigé Stradivarius dans la facture des beaux instruments produits depuis 1700 jusqu’en 1725. Il ne s'en écarta pas dans ses derniers travaux, mais le grand âge où il était parvenu lui enlevait par degrés la fermeté de sa main. Ce n'est pas la forme qui est essentiellement altérée dans les derniers instruments qui portent son nom ; c'est l'exécution qui est devenue timide. Ses plus beaux instruments connus sont. 1° celui qui appartient au grand duc de Toscane ; 2° celui de M. Alard ; 3° celui de Viotti, qui appartient à M. Brochant de Villiers ; 4° celui d'Artot, qui est en la possession de M. le comte de Cessol, à Nice ; 5° celui de M. Boissier, à Genève ; et, enfin, ceux de messieurs Bitz, Godiny, Plawdens, et Fountain, à Londres.
Ces mêmes principes, si riches de résultats, le maître les communiqua à ses meilleurs élèves immédiats, à la tète desquels se placent Joseph Guarnerius, génie original et capricieux, puis Charles Bergonzi imitateur plus exact du maître, et dont on a d'excellents instruments. Francois Stradivarius a fait aussi quelques bons violons qui, depuis 1725 environ jusqu'en 1740, portent son nom ; mais on en connaît d'autres faits en commun avec son frère Omobono, et qui portent cette inscription : Soito la discipline d'A. Stradivarius, Cremona. Omobono Stradivarius s'occupa plus particulièrement de la réparation et de la monture des instruments que de leur fabrication. Il mourut dans les premiers jours de juin 1742, et fut inhumé le 9 de ce mois, ainsi que le prouve un extrait authentique de l'église Saint Dominique de Crémone (A di 9 Giuno 1742. - Dato sepoltura al fù sigr, Omobono Stradivari, sepolto nella capella del Rosario, nella sepoltura del sigr Francesco Vilani, Parocchia di S. Mateo. - In fede, Fusetti Giulio vic°.) Son frère Francois ne lui survécut que onze mois, car il fut enterré le 13 mai 1743, ainsi que le démontre un extrait des mêmes registres (A di 13 Maggio 1743. - Dato sepoltura al fù sigr Francesco Stradivari, sepolto nella capella del Rosario nella sepoltura del sigr Francesco Vilani, Parocchia di S. Mateo. - In fede, Fusetti Giulio vie°.) Tous deux furent réunis dans le même tombeau avec leur père.
Les autres élèves immédiats d'Antoine Stradivari sont Michel-Ange Bergonzi, de Crémone ; Laurent Guadagnini, également de Crémone ; Francois Gobetti, de Venise, et Alexandre Galiano, de Naples. Ils sont rangés dans l'ordre chronologique suivant par leurs travaux :
I° Franciscus Gobettus, Venetus 1690 à 1720
2° Alexander Galianus, Neapoli 1695 à 1725
3° Lorenzo Guadagnini, Cremonae 1695 à 1740
4° Homobonus Stradivarius sub disciplina A. Stradivarii
5° Franeiscus Stradivarius.. sub disciplina A. Stradivarii 1700 à 1725
6° Homobonus Stradivarius, Cremonae. 1725 à 1740
7° Franciscus Stradivarius, Cremonae 1725 à 1730
8° Carlo Bergonzi Cremonae 1720 à 1750
9° Michel-Angelo Bergonzi, Cremonae 1725 à 1750
Parmi les luthiers italiens de troisième ordre, quelques-uns ont été élevés à l'école des Amati d'autres ont été formés par les élèves immédiats d'Antoine Stradivarius. On peut les ranger dans cet ordre chronologique :
Pietro della Costa, à Trévise 1660 à 1680
Michel-Angelo Garani, à Bologne 1685 à 1715
David Teckler, à Roine 1690 à 1735
Carlo Giuseppe Testore, à Mlilan 1690 à 1700
Carlo Antonio Testore, à Milan 1700 à 1730
Paolo Antonio Testore, à Milan 1710 à 1745
Nicolo Galiano, à Naples 1700 à 1740
Gennaro Galiano, à Naples 1710 à 1750
Spiritus Sursano, à Coni ( Cunco ) 1714 à 1720
Tomaso Balestiere, à Mantoue 720 à 1750
Ferdinando Galiano, fils de Nicolo, à Naples 1740 à 1780
Jean-Baptiste Guadagnini, à Plaisance 1755 à 1785
Carlo Landolfi, à Milan 1750 à 1760
Alessanidro Zanti, à Mantoue 1770
Laurentius Sturionus (Storioni), à Crémone 1780 à 1795
Quelques luthiers, nés dans des pays étrangers, se sont formés en Italie dans l'école des Amati, ou dans celle d'Antoine Stradivari. A leur tète se place Jacques Stainer, originaire du Tyrol et fondateur d'une école de lutherie dans ce pays. Il naquit à Absom, près de Hall, ville du Tyrol, qui n'est qu'à trois quarts de lieue d'Inspruck, et travailla dans sa jeunesse à Crémone, chez Nicolas Amati. L'histoire de cet artiste est environnée d'obscurité et a une apparence romanesque ; mais on peut dire avec assurance qu'il fut un grand maître. Sa gloire fut obscurcie, et ses instruments n'ont pas le prix qui devrait être donné dans le commerce à ceux qui sont réellement sortis de ses mains, parce que des luthiers tyroliens de troisième ordre ont mis souvent son nom à leurs instruments médiocres pour en relever la valeur. La plupart des prétendus Stainer répandus dans le commerce ont cette origine. es instruments vrais de ce maître se classaient autrefois par Lupot, excellent luthier de Paris, et par le violoniste Cartier, en trois époques. A la première appartiennent les violons datés de Crémone, qui ont des étiquettes écrites et signées de la main de Stainer : ils sont de la plus grande rareté. On les reconnaît à ces signes caractéristiques ; ils sont de petit patron ; les f sont petites et étroites ; les volutes moins allongées que celle des Amati, et plus larges dans la partie antérieure. Le bois est à larges veines, et le vernis est celui de Nicolas Amati. Un bel instrument de cette époque avait passé de la succession de M. Desentelles, ancien intendant des menus plaisirs du roi, dans les mains de Gardel, premier maître de ballets de l'Opéra, et amateur de violon distingué. Il porte la date de 1644.
Il règne tant d'obscurité sur la seconde époque de Stainer, les événements sont rapportés d'une manière si contradictoire, qu'en l'absence de documents authentiques, on ne peut que s'abstenir. Tout ce qu'on peut tirer de renseignements de ses instruments vrais produits dans cette époque, c'est que Stainer vécut et travailla à Absom depuis 1650 jusqu'en 1667. On dit qu'il fut alors aidé dans ses travaux par son frère Marc Stainer, qui était moine. Un violon qui a appartenu au marquis de la Rosa, grand d'Espagne, et qui a été entre les mains de Lupot ; celui du comte de Marp, amateur de violon à Paris ; celui qui appartenait à Frey, ancien artiste de l'orchestre de l'Opéra et éditeur de musique ; enfin, un alto admirable qui était en la possession de Matrot de Préville, ancien gouverneur du port de Lorient, étaient autrefois les seuls, instruments de la seconde époque de Stainer reconnus authentiques à Paris. Aujourd'hui le célèbre violoniste M. Alard en possède un de la plus grande beauté.
Suivant la tradition, Stainer se serait retiré dans un couvent de bénédictins après la mort de sa femme, et y aurait passé le reste de ses jours. Ce serait là qu'il aurait voulu clore sa carrière par la confection de douze violons d'un fini précieux qu'il envoya aux douze électeurs de l'Empire. J'ai vu entre les mains de Cartier, en 1817, un violon qui avait appartenu autrefois au duc d'Orléans, aïeul du roi Louis-Philippe, puis qui était passé dans la possession du violoniste Navoigille, et enfin dans celles de Cartier : on le disait un de ces douze instruments précieux. La sonorité pure, argentine et claire était charmante. Le vernis était d'un beau ton doré.
Il existe en ce moment à Paris un instrument véritable de Stainer, que j'ai entendu jouer par Sivori, et qui, bien que d'un très petit patron, a un éclat de sonorité extraordinaire et très sympathique. M. le comte de Castel-Barco, à Milan, possède aussi un alto de ce maître, qui est un modèle de perfection quant à la facture, et dont la sonorité est de la plus grande beauté. Cet amateur distingué possède deux quatuors de Stradivarius, instruments très remarquables ; un autre de Joseph Guarnerius ; un quatrième de Nicolas Amati ; et enfin un quatuor de Stainer, dont fait partie l'alto qui vient d'être cité. Ces instruments, appropriés au genre de musique avec lequel ils ont de l'analogie, produisent des effets qu'on n'obtiendrait pas avec d'autres.
De l'école de Stainer est sorti Matthias Albani, qui naquit en 1621 à Botzen ou Bolzano, dans le Tyrol italien. Gerber cite de cet artiste un violon qui portait intérieurement. ces mots : Matthias Albanus fecit in Tytol. Bolsani, 1654. Les instruments de ce luthier ont les voûtes trop élevées : son vernis est d'un rouge brun. la troisième et la quatrième corde ont le son nasal ; la seconde a de la puissance et de la rondeur, et la chanterelle a de l'éclat, mais de la sécheresse. Albani mourut à Botzen en 1673 (Voy. Moritz Bermann, Oesterreichische biographisches Lexikon).
Le fils d'Albani, dont le prénom était aussi Matthias, naquit à Botzen vers le milieu du dix-septième siècle. Après avoir appris la facture des instruments chez son père, et avoir travaillé dans les ateliers de Crémone, il y fabriqua beaucoup d'instruments qui ont été estimés presque à l'égal des Amati. Gerber, qui l'a, confondu avec son père, cite de lui deux violons qui ont appartenu au violoniste et compositeur Albinoni dont un portait la date de 1702 et l'autre celle de 1709.
Il y a eu un autre AIbani, qui travaillait en Sicile dans la première moitié du dix-septième siècle. Ses instruments ne portent pas de prénom, et l'on ne sait rien de sa vie. Il existe à Bruxelles un petit violon dont le volume de son a de l'éclat, et qui a pour inscription intérieure : Signor Albani in Palermo 1633.
Matthias Klotz ou Clotz, luthier tyrolien, fut le meilleur élève de Stainer. Après la mort de son maître il établit une manufacture d'instruments dont les formes sont en général imitées de Stainer, mais dont le son a moins de distinction. La plupart des violons de Klotz ont été fabriqués depuis 1670 jusqu'en 1696. Il existe pourtant des instruments qui portent le nom de Matthias Klotz et une date postérieure ; mais on croit qu'ils ont été fabriqués par les fils de cet artiste, et que ceux-ci n'ont mis leurs noms aux violons et altos sortis de leurs ateliers qu'après la mort de leur père.
Georges, Sébastien et Égide Klotz, fils de Matthias, ont fabriqué des violons qui ne sont pas dépourvus de mérite ; mais qui sont moins recherchés en Allemagne que ceux de leur père. Ces artistes avaient, dit-on, pour habitude, lorsqu'un instrument de leur fabrique était meilleur que d'autres, et plus achevé dans les détails de la forme, de lui mettre une étiquette indiquant le
nom de Stainer ; c'est à cette fraude qu'il faut attribuer les faux Stainer qu'on trouve dans le commerce. Toute la famille Klotz a vécu dans le Tyrol, et y a formé de nombreux élèves, fondateurs de toutes les fabriques d'instruments du pays.
Il a existé un luthier du nom de Georges Klotz, en 1754 à Mittenwald sur l'Iser, près de Landshut, en Bavière. J'ai vu un violon de lui qui était daté de ce lieu et de la même année. Rien n'indique s'il était petit-fils de Matthias.
Parmi les luthiers étrangers à l'Italie qui ont travaillé chez Antoine Stradivarius, on remarque, 1° Médard, qui fabriqua ensuite à Paris, puis à Nancy, depuis 1680 jusqu'en 1720. Il fut le fondateur de la lutherie de la Lorraine. 2° Ambroise Decombre de Tournay (Belgique), qui, de retour dans sa patrie, fabriqua depuis 1700 jusqu'en 1735. On connaît de lui particulièrement de bonnes basses qui sont estimées. 3° Francois Lupot de Stuttgard, qui produisit en cette ville depuis 1725 jusqu'en 1750 : il fut le père du luthier du même nom qui s'établit à Paris dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. 4° et enfin Jean Vuillaume de Mirecourt, qui fit de bons instruments depuis 1700 jusqu'en 1740.
LES GUARNERI OU GUARNERIUS.
La famille Guarneri, de Crémone, a fourni plusieurs luthiers distingués, qui tous ont été surpassés par Joseph, devenu célèbre par l'excellence de ses instruments. Le chef de cette famille, André Guarnerius, naquit à Crémone dans la première partie du dix-septième siècle, et fut un des premiers élèves de Nicolas Amati. Il travailla depuis 1650 jusqu'en 1695 environ. Ses instruments se recommandent par une bonne facture dans la manière des Amati, bien qu'on remarque en eux certains détails particuliers qui les distinguent et les font reconnaître. Leur son est joli, mais peu intense et d'une courte portée. On les range dans le commerce parmi les instruments de second ordre.
On considère généralement Joseph Guarnerius comme le fils aîné d'André, et l'on dit qu'il fut élève de son père. Il travailla depuis 1690 jusqu'en 1730. Bien qu'il soit élève d'André, il n'a pas suivi ses modèles. Ses premières tendances furent de se rapprocher de Stradivarius, dont il était contemporain ; mais plus tard il imita la manière de son cousin, nommé Joseph comme lui, et dont il sera parlé tout à l'heure. Il a donc varié dans ses patrons et dans les détails de la facture ; néanmoins ses instruments ont de la qualité et sont estimés.
Pierre Guarneri, second fils d'André et frère du précédent, a travaillé depuis 1690 jusqu'en 1725. Ses premiers produits sont datés de Crémone ; mais plus tard il s'établit à Mantoue, où il a fabriqué un grand nombre d'instruments qui ne sont pas dépourvus de mérite, mais auxquels on reproche d'avoir les voûtes trop élevées et de manquer de brillant.
Il y a en un autre Pierre Guarneri, fils de Joseph, et petit-fils d'André. On a de lui des violons et basses datés de Crémone, depuis 1725 jusqu'en 1740. Dans ces quinze années il a peu produit. Ses instruments ressemblent à ceux de son père, dont il était élève, mais ils ont moins de fini.
Il me reste à parler du grand artiste de cette famille, Joseph-Antoine, appelé communément en Italie Giuseppe del Jesu, parce que beaucoup de violons sortis de ses mains portent sur l'étiquette cette marque IHS. Jusqu'à ce moment on n'a eu sur ce luthier célèbre aucun renseignement positif, et l'on n'a recueilli sur sa vie que des bruits vagues plus ou moins romanesques. Lui même avait donné l'indication la plus positive sur son origine en nous apprenant qu'il était neveu d'André, par cette inscription placée dans ses instruments : Joseph Guarnerius, Andreae- nepos ; mais l'on n'avait aucune indication sur la date de sa naissance. Grâces aux recherches persévérantes de M. Vuillaume, un document authentique est venu lever tous les doutes sur ces derniers points il est prouvé aujourd'hui que Joseph Antoine Guarneri, fils légitime des époux conjoints Jean-Baptiste Guarneri et Angela Maria Locadella, naquit à Crémone le 8 juin 1683, et qu'il fut baptisé, le 11 du même mois, dans la paroisse de Saint Donat, succursale de la cathédrale (Guarneri (Giuseppe Antonio) figlio de' legittimi conjugi Giovanni Battista Guarneri ed Angela Maria Locadella nacque nella parocchia di San Donato aggregata alla cattedrale il giorno 8 Giugno 1683 e battezato il giorno 11 del detto mese. -Libro di nati dall' 1669 al 1692, . G. Dalla cattedrale di Cremona, li 19 settembre 1855. Signé : Fusetti Giulio vic°)
Jean-Baptiste Guarneri, père de Joseph Del Jesu, dont il est ici question, était frère d'André. Il parait hors de doute qu'il était étranger à la fabrication des instruments, car on n'en connaît aucun signé de son nom. Il paraît même que ses rapports avec les membres de sa famille n'étaient pas intimes, car ce ne fut ni chez Joseph ni chez Pierre Guarnerius que son fils apprit la lutherie, mais chez Antoine Stradivarius.
Joseph Guarnerius del Jesu a travaillé à Crémone depuis 1725 jusqu'en 1745. Ses premiers essais ne se font remarquer par aucun signe caractéristique d'originalité, si ce n'est une certaine indifférence dans le choix des matériaux, dans les formes, qui sont variables, et dans le vernis. Quelques années plus tard on trouve des instruments faits avec soin : l'excellente qualité du bois des éclisses et du fond est pris sur maille, le sapin de la table est du meilleur choix ; le vernis, d'une pâte fine, élastique, est de la plus belle teinte, et peut rivaliser avec celui de Stradivarius. Les instruments de cette époque sont de petit patron ; leurs contours sont heureusement dessinés ; les voûtes, peu élevées, s'abaissent jusqu'aux filets par une courbe adoucie ; les parties intérieures sont en bon sapin. Une seule critique est applicable à ces instruments, à savoir, que les épaisseurs, particulièrement au. centre du fond, sont trop fortes ; défaut essentiel qui nuit à l'élasticité, à la liberté des vibrations, et conséquemment à l'éclat de la sonorité. Montés à la manière de l'époque où ils furent construits, ces instruments devaient manquer de puissance et de portée. Le caractère de l'originalité s'y fait remarquer, nonobstant les variations de formes auxquelles l'artiste s'abandonne encore.
Dans la troisième époque de sa carrière, Joseph Guarnerius nous offre une variété dans les formes de ses instruments plus étonnante encore, tout en conservant néanmoins ce caractère d'originalité et d'indépendance où se révèle son génie. C'est dans cette même époque qu'ont été produits quelques instruments admirables d'un grand patron, faits d'un bois excellent pris sur maille, et dans les meilleures conditions possibles en ce qui concerne les voûtes et les épaisseurs. Un beau vernis, aussi remarquable par sa finesse et son élasticité que par son coloris, garantit ces excellents instruments, dont le mérite égale celui des plus beaux produits d'Antoine Stradivarius, après avoir subi les changements nécessaires pour les besoins de l'époque actuelle.
Tout à coup, immédiatement après cette époque glorieuse de sa carrière, Guarnerius se montre si inférieur à lui-même dans les instruments sortis de ses mains, qu'il deviendrait méconnaissable si le cachet d'originalité qu'il a conservé jusqu'à ses derniers jours, dans certains détails, ne donnait la certitude que ces produits sont les siens. Pauvreté de bois, de travail, de vernis, voilà ce qui frappe l'œil des connaisseurs dans un certain nombre de violons, fruit dégénéré d'un grand talent déchu. Une semblable métamorphose serait inexplicable si la fin malheureuse de l'artiste, indiquée par la tradition, ne faisait connaître la cause d'un si grand et si déplorable changement. Les bruits répandus en Italie sur les infortunes auxquelles Guarnerius fut en butte dans ses dernières années sont vagues et contradictoires ; mais, en les comparant, on reconnaît avec certitude que la fin de ce luthier distingué n'a pas été celle d'un homme de bien. Le vieux Bergonzi, mort à Crémone en 1738, à l'âge de quatre-vingts ans, et qui était petit-fils de Charles, élève de Stradivarius, rapporte que Joseph Guarnerius del Jesu avait eu une existence peu régulière ; que, paresseux, négligent, il aimait le vin, les plaisirs, et que sa femme, née dans le Tyrol, n'avait pas trouvé le bonheur près de lui, quoiqu'elle l'eût souvent aidé dans ses travaux. Bergonzi ajoutait que Guarnerius avait été renfermé pendant plusieurs années dans une prison pour une cause maintenant inconnue, et qu'il y était mort en 1745. D'autres traditions ajoutent quelques détails à ces révélations : par exemple, on rapporte que la fille du geôlier lui procurait les bois qui lui étaient nécessaires, quelques misérables outils, et qu'elle travaillait avec lui. C'est à cette époque malheureuse qu'auraient été, produits les instruments peu dignes du talent de l'artiste. Cette même fille les colportait et les vendait à vil prix pour lui procurer quelque, soulagement dans sa misère. C'est elle aussi qui achetait, tantôt chez un luthier, tantôt chez un autre, le vernis dont il enduisait ses violons ; ce qui explique la variété de composition et de teintes qu'on remarque dans ces produits d'une époque désastreuse.
La réputation de Joseph Guarnerius ne s'est faite qu'après sa mort en Italie : elle a été beaucoup plus tardive en France. Je me souviens que dans ma jeunesse, tandis que le prix d'un beau Stradivarius était de cent louis, celui du meilleur Joseph Guarnerius ne s'élevait pas au-dessus de douze cents francs ; mais plus tard on leur a reconnu des qualités de grande sonorité qui les ont fait rechercher, et qui ont fait élever le prix des -violons de choix jusqu'à six mille francs. Parmi les meilleurs violons de ce grand maître on peut placer en première ligne celui dont Paganini jouait habituellement dans ses concerts, et qu'il a légué à la ville de Gênes, sa patrie ; celui qui appartient au célèbre violoniste M. Alard, et celui que possède M. Leduc, amateur à Paris ; enfin ceux de MM. Goding et Plawdens, de Londres.
Quelques luthiers italiens ont imité la manière de Joseph Guarnerius, particulièrement Paul-Antoine Testore, de Mlilan, Charles-Ferdinand Landolfi, de la même ville, et Laurent Storioni, de Crémone ; mais leurs produits ne sont classés que parmi les instruments de troisième ordre.
Ici finit l'histoire de la lutherie crémonaise, dont les phases ont été si brillantes pendant près de deux siècles. Aujourd'hui, la ville de Crémone, dont l'illustration historique est due aux travaux de quelques artistes de cette profession, n'offre plus rien qui rappelle cette ancienne splendeur de l'art. A l'exception de quelques personnes d'élite, la population n'a pas même conservé le souvenir des Amati, de Stradivarius et de Guarnerius.
L'ARCHET
de
FRANCOIS TOURTE.
L'archet, cette baguette magique à l'aide de laquelle le grand artiste nous émeut le cœur et l'imagination, ce talisman qui nous transporte hors du monde réel et nous fait éprouver les plus ineffables jouissances de l'idéal ; l'archet, comme toutes les créations de l'homme, a commencé par de timides essais ; ses premiers éléments ont été de légers bambous, de flexibles roseaux, courbés en arc et tendus par une mèche de crins grossièrement attachée aux deux extrémités. Des milliers d'années peut-être s'écoulèrent avant qu'on songeât à perfectionner cette construction primitive.
Les premières modifications importantes de l'archet paraissent appartenir à l'Arabie ; car on le voit représenté avec une hausse fixe parmi les ornements d'un recueil de poésies, dont le manuscrit, exécuté au temps des premiers califes, a appartenu à Langlès, conservateur des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale de Paris, au commencement de ce siècle, et a passé, après sa mort, dans la bibliothèque impériale de Vienne. Je possède un archet de ce genre, fait à Bagdad en bois de cerisier avec une tête où la mèche est retenue, et avec une hausse fixée dans une entaille à queue d'aronde de la baguette.
La figure d'instrument à archet, tirée d'un manuscrit du neuvième siècle par l'abbé Gerbert, et reproduite dans cet écrit, fait voir une disposition inverse de l'archet ; car c'est la tète qui a une élévation considérable, d'où part la mèche de crins, laquelle vient, en s'abaissant, s'attacher à la baguette même sous la main de l'exécutant. Des archets du même genre, et grossièrement exécutés, se voient dans quelques monuments du onzième siècle ; mais au siècle suivant, et surtout dans le treizième, des améliorations considérables y sont introduites : on voit à cette époque, dans les figures de quelques manuscrits et de certains monuments d'architecture, des archets dont la hausse est à la hauteur de la tête, et qui sont presque droits. Les archets des rebecs sont des arcs façonnés avec peu de soin ; leur construction peut faire juger du peu d'habileté des ménétriers qui en faisaient usage.
Dans le seizième siècle, l'archet commença à se perfectionner ; c'est alors qu'on voit la baguette, tantôt ronde, tantôt coupée à cinq pans, s'amincir en approchant de la tête, et cette même tête s'allonger démesurément. Dans le siècle suivant, l'art de jouer des instruments à archet se perfectionne ; on reconnaît la nécessité de modifier les degrés de tension du crin en raison de la musique qui doit être exécutée, et l'on satisfait ce besoin par l'invention de la crémaillère, bande de métal posée sur la partie de la baguette où se fixe la hausse, et divisée en un certain nombre de dents. Une bride mobile, en fil de fer ou en laiton, attachée à la hausse, servait à l'accrochement de celle-ci à l'un des degrés de la crémaillère, ou plus haut ou plus bas, suivant la tension que l'exécutant voulait donner aux crins. A cette époque, la tête était toujours très allongée et terminée en pointe qui se recourbait un peu en arrière : La baguette était toujours plus ou moins bombée. Tel était l'archet de Corelli et celui de Vivaldi. Ces deux maîtres, qui vivaient au commencement du dix-huitième siècle, n'avaient pas encore reconnu la nécessité de rendre la baguette flexible, parce qu'ils n'avaient point imaginé de colorer la musique par des nuances variées : ils ne connaissaient qu'une sorte d'effet de convention, lequel consistait à répéter une phrase piano après qu'on l'avait fait entendre forte.
Chose remarquable, la construction des instruments à archet était parvenue au plus haut point de perfection, tandis que l'archet était encore relativement à l'état rudimentaire. Plus varié dans son style que Corelli et Vivaldi, Tartini fit, vers 1730, d'heureuses améliorations dans cet agent duquel dépend la production des sons. Il en fit tailler de moins lourds dans des bois plus légers que ceux dont on avait fait usage jusqu'à lui ; il redressa la baguette, au lieu de la tenir bombée, fit raccourcir la tête, et fit faire des cannelures à la partie de la baguette qui est dans la main, afin d'empêcher qu'elle ne tournât entre les doigts. Le violoniste Woldemar, élève de Mestrino, qui se fit remarquer par ses bizarreries à la fin du siècle dernier et dans les premières années du dix-neuvième, avait recueilli une collection d'archets des anciens violonistes célèbres de l'Italie ; il a fait dessiner et graver ceux de Corelli, de Vivaldi, de Tartini, de Locatelli et de Pugnani, dans sa méthode de violon qui n'eut point de succès, et qui est malheureusement aujourd'hui d'une rareté excessive. Il est regrettable, sous ce rapport, que cette oeuvre indigeste ait disparu du commerce ; car il n'était pas sans intérêt de comparer les améliorations progressives, mais lentes, de l'archet. Ce qui résulte de tous les renseignements qu'on peut recueillir sur ce sujet, c'est que l'on ne commença à s'occuper d'une manière sérieuse des perfectionnements de l'archet que -ers le milieu du dix-huitième siècle.
Progression des améliorations successives des archets au XVIIe et XVIIIe siècles
N° 1. – Mersenne, 1620.
![]()
N° 2. – Kircher, 1640.
![]()
N°. 3 Castrovillari, 1660.
![]()
N° 4. – Bassani, 1680.
![]()
N° 5. - Corelli, 170.
![]()
N° 6. – Tartini, 1740.
![]()
N° 7. – Cramer, 1770.
![]()
N° 8. – Viotti, 1790.
![]()
On attribue à Tourte, de Paris, père de celui qui a porté l'archet à sa dernière perfection, la suppression de la crémaillère, et son remplacement par la vis à écrou qui fait avancer et reculer la hausse pour tendre le crin à volonté, à l'aide d'un bouton placé à l'extrémité de la baguette. Cependant, si j'ai bonne mémoire, je crois avoir vu des représentations d'archets à bouton et sans crémaillère d'une époque antérieure. Quoi qu'il en soit, Tourte père était habile ouvrier : il a fabriqué des archets cannelés d'un joli travail, et en a perfectionné les têtes au moyen d'entailles profondes qui permettaient de fixer la mèche de crins d'une manière plus solide et de l'étaler avec plus d'égalité. Vers 1775, son fils aîné fabriquait des archets estimés alors à cause de leur légèreté ; mais la plupart sont faits avec des bois de médiocre qualité ; lés baguettes sont trop minces, les têtes mal dessinées, les hausses trop étroites et souvent trop élevées.
Son frère aîné, François Tourte, connu longtemps sous le nom de Tourte le jeune, naquit à Paris en 1747, dans la rue Sainte-Marguerite, et mourut au mois d'avril 1835, à l'âge de quatre-vingt-huit ans. Destiné par son père à la profession d'horloger, il entra très jeune dans un atelier, ne fit point d'autre étude, et ne sut jamais lire ni écrire. Peut-être fut-il redevable à la profession qu'il exerça d'abord, de l'habileté et de la délicatesse de main dont il fit preuve ensuite dans la fabrication des archets. Dégoûté de son état après avoir passé huit années dans les ateliers d'horlogerie, parce qu'il n'y trouvait pas de bénéfices suffisants pour ses besoins, il embrassa la profession de son père et de son frère. A cette époque, les artistes distingués qui se trouvaient à Paris étaient dans la voie du progrès vers l'art de chanter sur leurs instruments, avec les nuances dont les grands chanteurs italiens avaient donné l'exemple. Tous désiraient des archets qui répondissent mieux aux effets qu'ils voulaient produire, et qui eussent à la fois plus de légèreté, de ressort et d'élasticité. Francois Tourte avait fait ses premiers essais avec des bois qui provenaient de douves de tonneaux à sucre, dans le but de déterminer les formes de l'archet et d'acquérir de l'habileté dans le travail sans faire usage de matériaux dispendieux. Il vendait ces premiers produits de sa fabrication 20 ou 30 sous. Chercheur infatigable, et pénétré de l'importante action de l'archet dans la production des sons, il essaya plus tard tous les bois qui lui partirent propres à réaliser ses vues ; mais il ne tarda pas à reconnaître que celui de Fernambouc seul pouvait lui donner les résultats qu'il cherchait, et que seul il réunissait la roideur à la légèreté.
L'époque des premières et importantes découvertes de Tourte s'étend de 1775 à 1780. Malheureusement les guerres maritimes de la France et de l'Angleterre étaient alors un obstacle sérieux à l'arrivée du bois de Fernambouc sur le continent, et le prix de cette précieuse denrée, en usage pour la teinture, s'était élevé jusqu'à six francs la livre. Le bois de Fernambouc destiné à la teinture est expédié en bûches ; celui qui est le plus riche en matière colorante est aussi le meilleur pour la fabrication des archets ; mais il est rare d'en trouver dont les bûches soient droites et peu défectueuses ; car ce bois est presque toujours noueux, gercé dans l'intérieur et courbé e n tout sens. Quelquefois, huit ou dix mille kilogrammes de Fernambouc présentent à peine quelques morceaux de droit fil et propres à fournir quelques bonnes baguettes d'archet.
La rareté du bois de Fernambouc, à l'époque dont il vient d'être parlé, explique le prix énorme auquel Tourte avait porté ses archets : Il vendait 12 louis (de 24 livres) l'archet dont la hausse était en écaille, dont la tête était plaquée en nacre, et dont les garnitures de la hausse et du bouton étaient en or ; ses meilleurs archets garnis en argent, et dont la hausse était en ébène, se vendaient 3 louis 1/2 ; enfin, les archets ordinaires, sans aucun ornement, étaient du prix de 36 francs.
Jusqu'en 1775, ni la longueur des archets, ni leur poids, ni leurs conditions d'équilibre dans la main n'avaient été déterminés : éclairé par les conseils des artistes célèbres dont il était entouré, Tourte fixa la longueur de la baguette pour l'archet de violon à 74 ou 75 centimètres, y compris le bouton ; celui de l'alto à 74 centimètres, et celui du violoncelle à 72 ou 73 centimètres. Ce fut alors aussi qu'il détermina la distance du crin à la baguette par les hauteurs de la tète et de la hausse, et qu'il obtint par ces -proportions l'angle nécessaire au crin pour l'attaque des cordes, en évitant l'inconvénient que celles-ci soient touchées par la baguette. Dans ces archets, la tête, plus élevée qu'autrefois, et conséquemment plus lourde, obligea Tourte à augmenter d'une manière sensible le poids de la partie inférieure, afin de rapprocher de la main le centre de gravité, et de mettre l'archet en équilibre parfait. C'est dans ce but qu'il chargeait volontiers la hausse et le bouton d'ornements métalliques qui en augmentaient la pesanteur. De là vient que, nonobstant la légèreté des archets unis, on préfère ceux qui sont ornés, bien que plus lourds en apparence ; car, dans les premiers, le centre de gravité s'éloignant de la main, le poids est plus sensible vers l'extrémité supérieure de la baguette, tandis qu'il se trouve dans les autres à la partie inférieure. Dans les archets dont l'équilibre est le plus satisfaisant, la longueur du crin est de 65 centimètres pour le violon, et le centre de gravité est à 19 centimètres, à partir de la hausse ; dans l'archet de violoncelle, la longueur du crin est de 600 à 620 millimètres, et le centre de gravité est à 175 ou 180 millimètres de la hausse.
M. Vuillaume a vu Tourte scier lui-même les bûches de bois de Fernambouc, pour obtenir le droit fil et pour que la maille fût placée comme elle doit l'être ; puis il courbait les baguettes à l'aide du feu. Quelques personnes ont prétendu (Norblin était de ce nombre) que Tourte ne courbait pas les baguettes de ses archets par le feu, et qu'il les sciait dans la bûche suivant la forme qu'elles devaient avoir ; mais ce procédé aurait été en contradiction manifeste avec le principe de la direction du droit fil, dont il avait reconnu l'excellence. Il est donc certain que c'est par la chaleur qu'il obtenait la courbure nécessaire. Il avait compris que cette courbure ne pouvait persister invariablement qu'autant que l'intérieur de la baguette était chauffé comme la superficie, afin que toutes les fibres concourussent à maintenir la permanence de la courbe. On a remarqué, en effet, que lorsque les baguettes ne sont chauffées qu'à la superficie, les fibres intérieures, qui n'ont pas subi l'action de la chaleur, restent dans leur état primitif et opposent une résistance constante à la direction de la courbe ; quelquefois même cette résistance est telle, qu'elle finit par ramener la baguette à son état normal, particulièrement lorsque l'archet a été exposé aux influences de l'humidité. C'est pour cette cause que les archets fabriqués au point de vue du bon marché se décambrent et n'ont aucune des qualités nécessaires.
Tourte donnait des soins minutieux à la préparation de la mèche de crins de l'archet. Il préférait les crins de France, parce qu'ils sont plus gros et plus solides que ceux des autres provenances. La préparation qu'il leur faisait subir consistait à les dégraisser par le savonnage ; puis il les passait dans l'eau de son, et, enfin, il les dégageait des parties hétérogènes qui avaient pu s'y attacher, en les plongeant dans une eau pure légèrement teintée de bleu. Sa fille avait pour occupation presque constante le triage de ces crins, pour en écarter ceux qui n'étaient pas complètement cylindriques et égaux dans toute leur longueur : opération délicate et nécessaire ; car un dixième au plus d'une masse de crins donnée est d'un bon usage, la, plupart ayant un côté plat et présentant de nombreuses inégalités. A l'époque où Viotti arriva à Paris, les mèches de crins des archets se réunissaient presque toujours en une masse ronde qui nuisait à la qualité des sons ; ce fut d'après ses observations à ce sujet que Tourte imagina de maintenir les crins de l'archet sous l'aspect d'une lame plate comme un ruban, en les pinçant à la hausse par une virole qu'il fit d'abord en étain, puis en argent. Plus tard il compléta cette importante amélioration par une petite lame de nacre qui recouvre le crin depuis la naissance de la mortaise de la hausse jusqu'à la virole, par laquelle elle est maintenue. Les archets enrichis de cette plaque furent appelés, dans l'origine, archets à recouvrements. Le nombre des crins déterminé par Tourte pour ses archets fut un peu moins élevé qu'il ne l'a été depuis qu'on s'est attaché à tirer le plus grand son possible des instruments : ce nombre varie aujourd'hui entre 175 et 250, en raison de la grosseur des crins.
C'est dans la distribution des forces et dans la perfection des baguettes que Tourte a été supérieur aux autres fabricants d'archets. On se demande aujourd'hui comment un homme dépourvu de toute instruction, et dont l'éducation avait été négligée au point de ne savoir ni lire ni écrire, a pu déterminer, par la seule puissance de son instinct et par la sûreté de son coup d'œil, les proportions de l'amincissement progressif de la baguette et du renflement vers la tête. Ses facultés ne le laissaient jamais en défaut à cet égard : ce qui le démontre invinciblement, c'est la préférence accordée par les artistes les plus habiles à ses archets sur tous les produits du même genre, et par le prix élevé qu'on leur donne dans le commerce. Leur réputation est universelle. La difficulté qu'on éprouve à s'en procurer, et la nécessité de les remplacer par d'autres qui les égaleraient en qualité a éveillé l'attention de la science, et l'on s'est attaché d'abord à la théorie de la production du son par l'action de l'archet sur les cordes. Sans entrer ici dans tous les développements des recherches qui ont été faites et des analyses auxquelles on s'est livré à ce sujet, je dirai que les savants ont reconnu ces points fondamentaux :
Si l'archet n'empêche pas une corde de vibrer par son action continue sur elle, tandis que le moindre contact d'un doigt suffit pour arrêter les vibrations de cette même corde, c'est que l'archet, en passant sur elle, la touche, non d'une manière continue, mais par une suite de chocs très rapprochés et si réguliers, qu'ils entretiennent le mouvement au lieu de le détruire. La régularité du phénomène dépend de l'élasticité particulière du crin, de l'action des parcelles de colophane dont il est enduit, et surtout de l'habileté de la main. Ceci explique la destination de la colophane dont on frotte les crins de l'archet : dépourvus de cet enduit, les crins glissent sur la corde sans en faire sortir le son, mais les aspérités que dépose la résine sur eux leur font produire ces chocs rapides et réguliers d'où résulte la continuité de la vibration.
C'est à peu près à ce seul résultat qu'est arrivée dans la science la théorie de l'archet ; car jusqu’à ce jour elle n'avait point donné la loi de la diminution progressive du volume de la baguette, trouvée instinctivement par Tourte, et si nécessaire pour la production de tous les phénomènes de force, de légèreté, de moelleux et d'expression par lesquels l'artiste manifeste son talent. C'est à M. Vuillaume de Paris qu'on est redevable de la découverte récente de cette loi, découverte où l'ont conduit ses observations intelligentes et attentives, et dont il a démontré la réalité par des procédés graphiques très ingénieux. Les résultats de ces procédés pourront être appréciés par l'analyse qu'on va lire, en ayant sous les yeux la planche où l'opération graphique est représentée.
DETERMINATION EMPIRIQUE
DE LA FORME DES ARCHETS DE TOURTE.
La longueur moyenne de l'archet, jusqu'à la tête exclusivement, est de 0m, 700.
L'archet comporte une partie cylindrique ou prismatique de dimensions constantes dont la longueur est de 0m, 110. Quand cette portion est cylindrique, son diamètre est de 0m, 0086/10.
A partir de cette portion cylindrique ou prismatique, le diamètre de l'archet décroît jusqu'à la tête, où il est réduit à 0m, 0053/10 ; ce qui donne entre les diamètres des extrémités une différence de 0m, 0033/10, ou 33/10 de millimètre, d'où se tire cette conséquence, que la baguette comporte dix points où son diamètre est nécessairement réduit de 3/10 de millimètre à partir de la portion cylindrique.
Après avoir constaté sur un grand nombre d'archets de Tourte que ces dix points se trouvent toujours à des distances décroissantes, non-seulement sur la même baguette, mais que ces distances sont sensiblement les mêmes et pour les mêmes points sur divers archets comparés, M. Vuillaume a recherché si les positions de ces dix points ne pourraient pas être obtenues par un procédé graphique qui permit de les retrouver avec certitude, et conséquemment de construire des archets dont les bonnes conditions seraient toujours fixées à priori : il y est parvenu de la manière suivante :
A l'extrémité d'une ligne droite AB ayant 0m, 700, c'est-à-dire la longueur de l'archet, on élève une perpendiculaire A C, ayant la longueur de la portion cylindrique, à savoir 0m, 110. A l'extrémité B de la même ligne on élève une autre perpendiculaire B D dont la longueur est de 0m, 022, et l'on réunit par une ligne droite C D les extrémités supérieures de ces deux perpendiculaires ou ordonnées, en sorte que les deux ligues À B et C D forment entre elles un certain angle.
Prenant avec un compas la longueur de 0m, 110 de l'ordonnée A C, on porte sur A B cette longueur, à l'extrémité de laquelle on élève, jusqu'à la rencontre de la ligne C D, une nouvelle ordonnée E F moins grande conséquemment que A C. C'est entre ces deux ordonnées AC et CF que se trouve la portion cylindrique de l'archet, dont le diamètre est, comme on l'a vu précédemment, de 0m, 0086/10
Prenant alors la longueur de l'ordonnée E F, on la porte sur la ligne A B, à partir du point F, et l'on a un point G sur lequel on élève une troisième ordonnée GH, dont on prend aussi la longueur pour la reporter du point C. sur la ligne AB, et y déterminer un nouveau point I, sur lequel on élève la quatrième ordonnée I J, dont la longueur, également reportée sur la ligne A B, déterminé le point où s'élève la cinquième K L. Celle-ci déterminera, dans les mêmes conditions, la sixième M N, et ainsi des autres jusqu'à l'avant-dernière y z, .
Les points G I K M O Q S V W Y ainsi obtenus à partir du point E, sont ceux où le diamètre de l'archet est successivement réduit de 3/10 de millimètre.
Or, ces points ont été déterminés par les longueurs successivement décroissantes des ordonnées élevées sur les mêmes points, et leurs distances respectives sont progressivement décroissantes depuis le point E jusqu'au point B.
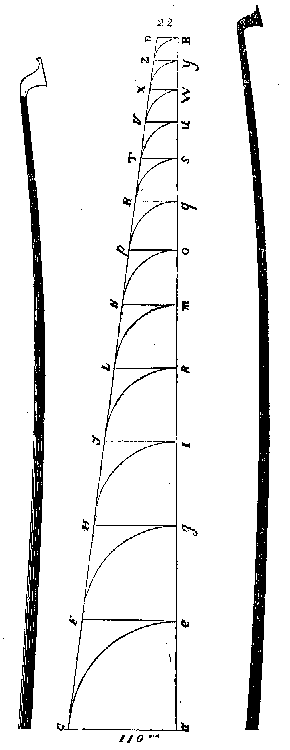
Si l'on soumet ces données au calcul, on trouvera que le profil de l'archet est représenté par une courbe logarithmique dont les ordonnées croissent en progression arithmétique, tandis que les abcisses croissent en progression géométrique, et qu'enfin la courbure du profil sera exprimée par l'équation :
Y= - 3, 11 + 2, 57 log. X ;
et, faisant varier x depuis 175 jusqu'à 765 dixièmes de millimètres, les valeurs correspondantes à y seront celles des rayons.
Ainsi se trouve formulée la théorie rigoureuse de l'archet de violon. Par un procédé graphique analogue on déterminera sans peine les proportions décroissantes de l'archet d'alto et de celui de violoncelle.
FIN.